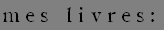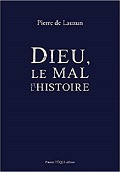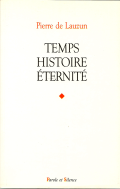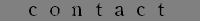
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
Le rôle du don dans l’économie
mercredi 14 septembre 2022
Un fait est clair : la place du don dans l’économie ne saurait se résoudre au rôle subalterne et périphérique qui lui est reconnu par la pensée commune. L’économie comprise de façon réductrice comme la seule activité marchande mesurable n’est qu’une partie de l’activité de l’homme. Des pans entiers essentiels de la vie commune échappent à sa logique, et notamment la gratuité. La famille en est un exemple évident, ou l’associatif. Plus largement, le don est essentiel à la constitution de tout lien social, comme je le rappelle à la suite de bien d’autres, notamment dans mon livre La finance peut-elle être au service de l’homme ?
On peut donc retrouver la problématique du don au sein même de l’activité économique. L’analyse habituelle du marché comme de l’Etat est donc terriblement réductrice. Inversement, vouloir remettre en cause radicalement l’économie (d’échange ou étatique), au profit du don, comme certains l’évoquent notamment en contexte chrétien, est comme tel une utopie.
Mais c’est l’occasion de réfléchir au rôle du don dans la société et plus particulièrement dans l’économie. On verra qu’il est essentiel et même vital, car c’est lui qui fonde la communauté. Et que cela joue de ce fait un rôle essentiel dans la vie même de ces formes de communauté de travail que sont les entreprises.
Le rôle central du don
Comme je le rappelais dans La finance peut-elle être au service de l’homme ? , notamment sur la base des travaux de J. Godbout, « l’utilitarisme façonne notre pensée, or pour lui le vrai don serait désintéressé et c’est impossible ; il ne connaît dès lors que l’Etat et le marché. Mais une personne qui nie la pertinence du don vit en général elle-même pour sa famille, à qui elle donne gratuitement une bonne partie de son temps et de son argent. C’est plus généralement le don qui crée la relation dans la société puisque le lien qu’il crée persiste dans le temps et n’est pas annulé par un paiement comme dans une opération commerciale. En outre, la société est composée d’hommes qui cherchent à se séduire et à s’apprivoiser en créant des liens, ce qui prend du temps et demande certains actes, dont principalement les échanges de dons, même s’ils sont plus ou moins orientés vers une contrepartie ultime. »
« L’homme n’agissant que dans le cadre d’une société, il a un besoin vital du lien social. […] S’il n’y a plus de lien, il ne reste que l’individu, solitaire plus que libre, fragile et vulnérable, et surtout stérile. Mais si on a un besoin vital de lien social, on a un besoin du don, même dans les activités ayant une dimension matérielle importante, donc en économie aussi. […] La logique du don a sa place à l’intérieur de l’activité économique normale, car lui seul crée de la socialité : une entreprise par exemple péricliterait si les employés ne donnaient pas plus que ne vaut leur salaire ; de même l’administration si les fonctionnaires n’avaient aucun sens du service public. »
Activité économique et relations humaines
Une première étape alors est la reconnaissance de l’enjeu essentiel des relations humaines, y compris dans l’activité économique. Une source majeure de réflexion est ici l’école italienne de l’économie civile. Simona Beretta développe par exemple cette question de façon stimulante. Elle montre que la source principale de richesse qui est le travail humain, et son effet, qui est le développement personnel ou social, impliquent des relations personnelles, ce qui est à l’opposé de la relation impersonnelle et contractuelle supposée prévaloir sur les marchés ou les lieux de travail. En fait, tous les actes économiques qui comptent supposent une relation personnelle, souvent durable, surtout dès qu’il y a asymétrie d’information, économies d’échelle, concentration de pouvoir etc. La confiance a une valeur économique spécifique, et elle comporte une forte dimension personnelle. Et la dimension interpersonnelle, amicale, implique usage du don comme on l’a vu. Mais attention : à nouveau, cela ne veut pas dire que des relations de ce type soient toujours bonnes en soi. Les relations humaines sont ambivalentes, le don compris. Tout dépend du sens de la relation ; dans le mauvais cas, le résultat peut en être une forme de dépendance.
Le fait est pourtant, poursuit-elle, que dans le langage courant le mot ‘gratuit’ contient une connotation quelque peu dépréciative : si c’est gratuit, c’est irrationnel. En outre, une gratuité consciente totale ou presque est rare : c’est surtout la relation des parents avec leurs enfants. Mais justement, dans cette optique l’intérêt de ces relations de don ne se limite pas à leur contribution au fonctionnement de l’économie. L’accès matériel à des biens est une chose ; la qualité de la relation humaine, une autre. Si on cherche à optimiser sur la base d’un pur résultat matériel, la recherche du bien moral apparaît comme un coût, une contrainte extérieure, et le don sera jugé irrationnel. Mais c’est différent si l’optimisation est comprise plus largement. La circulation des biens dans le marché, tout comme les circuits bureaucratiques verticaux, réduits à eux-mêmes engendrent une forme pauvre de développement. Mais si on conçoit le développement plus largement, on inclut la possibilité d’une circulation de dons, insérée dans le temps. Il se crée alors une relation libre, mais où le receveur est engagé dans une forme de dû envers le donneur, avec des obligations réciproques, qui restent libres et non hiérarchiques. Et ceci comporte nécessairement des relations humaines larges. L’idée est donc, dit S. Beretta, que « la force des relations de ‘don’ à l’intérieur des sociétés est cruciale pour le développement ». Notamment s’il s’agit de s’adapter à des environnements changeants et de créer de nouvelles initiatives. En outre, il faut en permanence entretenir et renouveler les relations au sein de la société, l’alliance qui en est à la base : il faut prouver à chaque étape que la confiance mutuelle est méritée.
De son côté, S. Zamagni nous rappelle que la science économique doit s’ouvrir à l’aspect relationnel, car le cœur de notre position au sein de la société n’est pas dans des règles, mais dans ‘l’être avec’. Au départ dit-il, l’économie de marché comportait, outre l’échange et la redistribution, le principe de réciprocité. Mais il s’est perdu avec la révolution industrielle, d’où la réduction de l’économie au couple Etat/marché, et une série de dilemmes, comme celui entre efficacité et justice distributive. D’où aussi la faiblesse de la production de biens relationnels dans nos sociétés (dans lesquels le rôle du don est essentiel). Nos sociétés se fondent, dit-il encore, sur une concurrence pour l’acquisition de biens de position (ceux censés vous donner un statut dans la société, au moins une image), qui sont en quantité limitée et consommés, plus que pour celle de biens relationnels (qui créent une vraie relation) ; d’où le sentiment de solitude, et l’absence de corrélation qu’on constate entre richesse et bonheur, car ce dernier dépend des relations entre personnes. Mais la société n’est pas viable sans une forme de fraternité ; la personne n’est pas simplement dotée de relations, elle en est constituée. Dans la réciprocité, le bien apporté par la relation dépend directement de la connaissance de la personne qu’on a en face. Si on veut que cette réalité se traduise aussi dans l’échange, il faut donc, dans le marché aussi, des acteurs orientés vers la relation.
Ce n’est pas un pur vœu pieux, c’est une constatation rationnelle ; à un niveau simple, l’exemple du dilemme du prisonnier le montre dans la théorie des jeux : quand la relation existe, elle change radicalement, en bien, le résultat de l’interaction. En outre, la pratique de la réciprocité modifie nos hiérarchies de priorités. Il faut donc que les acteurs, inspirés par le principe de réciprocité, comprennent qu’il y a des transferts qui sont indissociables des rapports humains, et cela dans le marché aussi.
Une telle conception est distincte de celle fondant l’Etat-providence. Ce qu’on appelle ‘droits sociaux’ dans ce dernier cadre est fondé sur une idée de devoir, assumé par l’Etat. En revanche, les ‘biens de gratuité’ nous fixent une obligation intérieure, nécessaire au bonheur, et plus qu’une vertu éthique, c’est l’idée d’un autre type de relation, qui participe en un sens du spirituel. En outre, le marché considéré en lui-même ne crée pas de résultat coopératif, de confiance. Or le manque de confiance mutuelle est un facteur majeur de sous-développement (et, peut-on ajouter, une source de coûts et de mauvais fonctionnement du marché). L’échange ne peut produire un fonctionnement optimal si ces biens d’ordre culturels ne sont pas présents.
Le fondement dans une éthique du bien commun et des vertus
Stefano Zamagni nous rappelle ici un positionnement anthropologique qui est celui de la pensée classique, qui situe la personne humaine comme à la fois relationnelle, et orientée vers son bien qui suppose un bien commun. Dans la société sécularisée on parle d’intérêt général ; ici on parle de bien commun. Cela implique une culture de la chose commune, imprégnant autant que possible la société, non comme une réalité mise en surplomb, comme le fait l’Etat ou l’autorité publique, mais irriguant l’ensemble des relations humaines, y compris les marchés. On pourrait être tenté d’y voir une forme d’utopie ; cela serait le cas si c’était un programme d’ensemble reconstruisant la société sur cette base. En réalité c’est bien plutôt à voir comme une dimension de la réalité, qui n’est pas mise en valeur et prise en compte explicitement dans le cadre de nos sociétés, mais qui peut être reconnue comme une composante importante de cette réalité, à encourager et faciliter autant que faire se peut.
Une telle conception éclaire alors une autre question centrale, celle de l’éthique, qui est dans une large mesure une question culturelle, une question de formation, dans une optique qui est aussi celle du bien commun. Ce qu’on appelle habituellement éthique relève de l’éthique de responsabilité, qui fixe nos devoirs envers les autres parties prenantes, ce qu’on peut élargir à l’idée de solidarité et au souci de la relation. Plus largement, dans une forme d’autorégulation une majorité d’acteurs peut voir un intérêt pour chacun à fonctionner dans un cadre où tout n’est pas permis et où on consent pour soi à des limites car les autres s’y soumettant aussi, chacun est gagnant ; à conditions bien sûr que l’idée soit bien accréditée dnas la population concernée. Mais, entre autres limites, cela ne garantit pas le respect de cet idéal ou de ces règles. Le principal ressort de rappel externe est alors la réputation ; c’est un facteur réel, mais il est vulnérable, et il se fonde souvent sur un calcul rationnel d’intérêt qui peut être remis en cause lorsqu’il y a intérêt à le rompre. Dans la pensée contractualiste dominante, c’est l’accord sur un contrat qui fonde l’obligation. Mais cela n’en ferait une obligation intériorisée que s’il y avait consensus réel de tous sur les règles adoptées, et acceptation de l’idée que cela nous lie intérieurement. Or ce n’est pas le cas dans nos sociétés, dans la mesure où on y comprend la liberté comme une absence de contrainte. Il n’y a donc pas de ressort de rappel, et le système mine l’éthique ainsi définie. L’éthique des vertus de la tradition classique est très différente. Elle gouverne l’ordre des préférences lui-même : on respecte le code éthique parce qu’on lui donne une valeur en lui-même, et cela pour nous-mêmes. La voie ainsi comprise est meilleure, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Il ne s’agit pas ici d’imposer des règles et contraintes, mais de modifier la représentation qu’on se fait du bien et son rôle dans notre agir, y compris économique. Notons la différence avec l’idée moderne d’incitation, qui vise à nous orienter mais nous laisse centrés sur nous, et diminue la confiance puisque nous savons que c’est un prix payé, ce qui nous conduit à nous interroger sur les motivations sous-jacentes de l’autre et sur sa détermination à respecter ses engagements.
L’utopie d’une économie du don
Faut-il aller plus loin et remettre en cause radicalement l’économie (d’échange ou étatique), dans son anthropologie même, au profit du don ? En contexte chrétien plus particulièrement, une alternative évoquée par certains serait une économie dans laquelle le don, voire la communion, joueraient un rôle central. C’est ce que plusieurs auteurs américains comme Daniel M. Bell Jr., David L. Schindler ou Adrian Walker nous expliquent avec force. Ils partent d’une critique sévère du système capitaliste et de son système de valeurs, centré sur l’intérêt et le désir supposé insatiable, traitant tout comme marchandise, et ils vont aussi jusqu’à contester l’idée même de rareté. En face de quoi ils mettent en avant le rôle du don et du bien commun, grâce au recentrage sur l’autre et ses besoins : nous sommes des personnes en communauté, vulnérables aux autres et dépendants, et non des individus isolés. La personne est en elle-même une richesse, qu’on peut appeler ontologique. Parallèlement, soulignent-ils, cette réflexion conduit à un souci qualitatif portant sur les biens eux-mêmes, notamment à ne pas fétichiser les réalités économiques, et à ne pas voir les autres comme des instruments pour nos désirs. Et donc à ne pas faire une dichotomie entre une économie qui obéirait à des lois non éthiques, et un comportement de don ou de solidarité qui interviendrait ensuite. C’est alors notre attitude permanente qui est en jeu, y compris quand nous agissons dans le monde économique. Cela dit, ils n’en déduisent pas véritablement une économie radicalement différente ; ils admettent les réalités économiques de base : production, consommation, marchés, profits, contrats, division du travail etc. Mais ils visent à bouleverser la logique des relations, quitte à avancer par petits pas. Ce qu’ils nous demandent en définitive est de répondre à notre vocation, c’est-à-dire de faire ce que nous avons à faire là où nous sommes (devoir d’état), parce que nous y sommes appelés, mais avec un état d’esprit profondément différent, tourné vers l’autre ; et ce faisant d’agir concrètement, par petits pas, où c’est possible.
Mais du coup, c’est leur fondement théorique qui paraît étrange, et notamment leur critique radicale de la rareté et du marché. Prenons par exemple le marché : si on récuse le rôle de démiurge de la main invisible, mais qu’on admet que le marché a un rôle légitime, comment le comprendre ? Accepter une confrontation d’offres et de demandes, portant sur des quantités et des prix possibles de biens à échanger suppose par définition une forme de rareté, qui n’est pas explicable par le seul égoïsme ; elle suppose aussi la confrontation d’ordres individuels, nécessairement imparfaits et partiels. Ce qui apparaît alors est que leur analyse critique du capitalisme était, au départ, insatisfaisante : la forme idéologique de ce dernier, qui exclut toute considération éthique ou spirituelle, est contestable. Mais l’idée d’une rareté (dépendant de l’état de la société) est indiscutable ; en outre, l’action des hommes est loin d’être mue par le seul altruisme et a besoin de guidage et d’information ; elle doit donc être coordonnée et arbitrée par des procédures et des mécanismes, dont le marché et l’Etat. Marché et entreprise ont en outre l’immense avantage de laisser la personne plus libre de se déployer et d’assumer des choix.
Il faut donc distinguer les niveaux. L’un est la critique de l’anthropologie qu’on trouve dans bien des manuels d’économie, avec sa réduction simpliste de l’homme à l’homo economicus qui en imprègne toute la dimension prescriptive, et se prolonge concrètement dans la financiarisation de l’économie, par laquelle elle structure notre vie collective. Une telle critique est indiscutable. Mais, en même temps, il faut intégrer ces préoccupations dans le contexte réel. Or les outils de l’économie ne supposent pas en soi de réduire de façon nécessaire l’homme à l’homo economicus ; c’est vrai par exemple à nouveau de la confrontation des offres et demandes de biens sur un marché, et de son fonctionnement même : le marché est un outil de la société, dont le résultat dépend directement des priorités des acteurs, y compris éthiques et sociales, et de leur comportement effectif. Il n’est donc pas en soi mauvais, au contraire ; il est non seulement compatible avec une anthropologie saine, mais il en fait nécessairement partie.
Tout autre est le niveau d’une possible utopie : l’idée d’une société qui parviendrait à fonctionner sur un principe de don et de partage devenant le moyen normal de l’activité économique. La généralisation du don tombe en effet à nouveau sur la question de la rareté. On connaît les limites de l’échange marchand, par exemple par rapport à la famille ou à l’environnement. Mais le don généralisé ne procure pas une certitude de rationalité supérieure ; il peut tout autant conduire à la négligence de la famille ou de l’environnement, ou à des comportements absurdes de type potlatch. En outre, il est peu vraisemblable que, dans la sphère des échanges, il régule la rareté comme réussit à le faire l’échange marchand (ou la réglementation). Si je donnais toute ma production à la société, je n’aurais aucune garantie qu’on me donnerait ce que je désire, ou même ce à quoi j’ai droit (sauf collectivisation, dont on connaît l’inefficacité). D’autant qu’il n’y aurait aucun moyen de comparer ce que je donnerais avec ce que je désirerais. Et donc (sauf cercles restreints et unis affectivement, comme en famille), cela ne fonctionnerait que si les apports et les désirs étaient très étroitement balisés, donc dans une société très frugale et surtout très contrôlée. L’argument d’Adam Smith sur le fait que le boulanger me procure mon pain parce qu’il y a intérêt est certes dangereux s’il limite les relations à cette seule dimension ; mais il contient une observation indiscutable : le levier de l’intérêt est plus universellement et constamment présent, et dans le cadre de l’échange marchand, il conduit les deux parties à prendre en compte les intérêts de l’autre. A sa façon il introduit une dimension de prévisibilité et par là de confiance, même si celle-ci recouvre une réalité bien plus large.
Il faut donc rappeler à nouveau l’utilité fondamentale d’une économie décentralisée, d’initiative et de propriété privée, et donc de l’entreprise et du marché. La divergence de nos auteurs avec l’économie actuelle est fondamentalement dans le système de valeur et de priorité, tant des acteurs que de la société et de ses règles. Mais dans la réalité un tel changement du regard, voire une conversion, sont inévitablement imparfaits et partiels ; et le besoin d’institutions de régulation économique subsiste, donc le marché, les prix, l’entreprise, les réglementations publiques etc. Une société même utopique ne pourrait pas fonctionner sans ce type de régulation. Même dans une société qui serait profondément altruiste, tant la confrontation des offres et demandes sur un marché que la régulation publique, resteraient indispensables pour arbitrer entre les désirs et les possibilités et donner une indication de prix, sur la base de laquelle des raisonnements économiques sont possibles.
Nous déduisons de ces analyses que le don est essentiel dans la constitution de la société ; mais aussi qu’on ne peut pas envisager de construire l’ensemble des rapports sur le don. Non seulement parce que ce n’est pas faisable, comme on l’a noté, mais aussi parce que ce ne serait pas vraiment souhaitable. Dans la réalité sociale, le don est un système de rapports, lui aussi porteur de contraintes, et il présente ses propres inconvénients. Dans les sociétés anciennes, le rapport de supériorité sociale des classes dirigeantes comportait des échanges de dons avec les catégories inférieures. Cela créait des rapports sociaux qui étaient certes des sources puissantes de liens intenses, mais inégaux et parfois oppressifs. En revanche bien sûr, la place congrue qui est faite au don dans nos sociétés (et plus encore dans nos mentalités conscientes) n’est pas non plus satisfaisante, et encore moins le formidable appauvrissement des rapports sociaux que cela entraîne. D’où le besoin de reconnaître son rôle indispensable et de lui faire la place nécessaire.
Ce n’est pas impensable. Une comparaison très intéressante est faite par Thomas Piketty dans Capital et idéologie, entre les biens patrimoniaux détenus par l’Eglise dans les Anciens régimes, soit entre 25 et 35 % des actifs de la société concernée, ce qui lui donnait une capacité d’action souvent supérieure à celle de l’Etat, et le secteur non lucratif actuel, qui, dit-il, détient seulement aujourd’hui 1% des actifs en France, et 6 % aux Etats-Unis (et encore cela comprend des fondations qui sont au service d’une cause, en général définie par une famille et pas toujours purement altruiste). La signification de cette différence est manifeste : certes, notre société fait assumer les rôles correspondants par l’Etat. Mais justement, pour équilibrer l’activité marchande, elle ne laisse plus de rôle au don, et ne table que sur la coercition pure, l’impôt. Une autre conception est donc possible.
Gratuité et don dans la vie économique, concrètement
Tout ceci interpelle directement la conception économique moderne, du fait du rôle central qui y est joué par la recherche et la mesure d’un résultat monétaire. L’idée d’insérer de la gratuité et par là le souci de la relation dans nos relations heurte le ‘bon sens’ actuellement dominant. Mais de quoi parle-t-on ici précisément ? On comprend spontanément la gratuité comme le fait de ne pas attendre un retour, quel qu’il soit, de l’action menée. Or il ne s’agit pas de rêver d’une gratuité absolue, encore moins de promouvoir un ‘acte gratuit’, quasiment existentialiste. Même en ‘donnant’ un sourire, d’une certaine façon on attend en général quelque chose ; même la charité la plus désintéressée du chrétien fervent attend en un sens quelque chose, au moins de Dieu, et les Evangiles y encouragent. Inversement, cela comporte au minimum de reconnaître l’existence de l’autre et une forme d’interdépendance, c’est-à-dire de relation.
Même en restant dans le cadre de l’activité économique classique, ce dont il s’agit est de ne pas attendre ou escompter systématiquement un retour, en tout cas pas un retour considéré sûr ou probable, et a fortiori prévu juridiquement, et de ne pas le calculer ou le tarifer en permanence. Cela se relie en dernière analyse et à nouveau à la création du lien social. Et donc tout simplement au fait de se soucier des autres. C’est manifeste dans le cas du fonctionnement interne d’une entreprise : si chacun calculait en permanence le retour attendu de chaque geste fait au profit de collègues ou de l’entreprise elle-même, la vie dans cette entreprise serait invivable et elle serait inefficace. Mais cela déborde manifestement ce cadre et vise la vie économique dans son ensemble. Le fait humain premier est à nouveau le lien social, la communauté, et la nécessité de le nourrir et de l’enrichir ; en économie, cela se traduit par une production en commun de biens et de services, utile à d’autres. La communauté suppose un bien commun (celui-là même qui résulte de son existence comme telle), une solidarité, et que chacun en retire ce qu’il est juste qu’il en retire. Ces objectifs sont en eux-mêmes gratuits au sens qu’on a évoqué de la non-attente d’un résultat immédiat calculable : déjà, si je suis simplement juste envers les autres, ce n’est pas en vue d’un résultat immédiat, et sûrement pas escomptable. Un premier effet, minimal, de ces réflexions est de se rappeler que le résultat économique, le profit, est d’abord un outil technique de gestion visant à vérifier que la communauté que nous formons utilise au mieux les ressources disponibles (et produit plus qu’elle ne consomme). Mais si c’est une vérification finale, ce ne doit être ni l’obsession de tous les instants, ni le seul critère.
Une analyse précise et convaincante du rôle du don dans l’entreprise comme moyen indispensable de la création du lien social et par là de l’activité commune nous est fournie par Pascal Ide, Bénédicte de Peyrelongue, Anouk Grevin, Jean-Didier Moneyron dans leur livre Recevoir pour donner (Relancer la dynamique du don au travail) (2021). Ils montrent que l’action effective de chacun dans l’entreprise ou plus généralement sur le lieu de travail comporte toujours une part de don, qui non seulement ne relève pas du calcul ou du contrat, mais se trouve amoindrie si pour une raison ou une autre on veut le ramener à cela : le don relève de l’intérêt de ce que l’on fait et du sens que prend notre interaction avec les autres. Celui qui par exemple se donne à fond à son travail peut mal prendre non seulement l’absence de reconnaissance de cet effort, mais aussi sa requalification en dû, ou sa récupération par le marketing. Parallèlement, le manager qui croit tout donner peut par-là fermer la possibilité pour ses collaborateurs d’une contribution propre de leur part : il faut donc savoir aussi recevoir. Chacun doit donner, reconnaitre le don des autres, et recevoir. Ils résument leurs conclusions opérationnelles en 4 propositions : le don n’est pas toujours où on l’attend et il faut savoir l’accueillir pour le qualifier (et donc déjà le voir, et reconnaître son rôle) ; trop de prescription peut faire disparaître le don (si c’est un devoir, ce n’est plus un don, mais alors le salarié n’en fait pas plus que ce qui est stipulé) ; percevoir le don suppose la proximité (notamment avec les personnes) ; enfin le cycle des dons a besoin d’une juste réciprocité (chacun doit donner et recevoir). Il faut donc une attention constante à la gestion de ces échanges selon la logique du don, sans quoi les personnes vivent et travaillent mal ensemble. Et donc même le bon fonctionnement et les résultats mesurables supposent une bonne intégration du jeu des dons réciproques.
Patrimoine et immatériel : au-delà des flux comptables
Nous venons d’évoquer le rôle central du don. Mais nous avons vu dans d’autres articles sur l’investissement éthique le besoin impérieux d’élargir les critères des propriétaires comme des dirigeants d’entreprises, pour inclure d’autres considérations que le résultat comptable, à commencer par l’environnement, le social etc. Or ces critères ne sont eux aussi pas calculables, ou pas tous, en tout cas pas comme le résultat économique classique. Là aussi il faut donc dépasser le résultat purement économique. Cela va au-delà de ce fait simple mais essentiel que sont les graves limites de nos méthodes comptables, et je ne parle pas ici seulement des normes IASB, centrées sur une valeur de marché qui peut être discutable, mais de toute comptabilité, si utile soit-elle. C’est même vrai du point de vue du fonctionnement de l’économie classique elle-même : notamment, sans le patrimoine collectif immatériel, dans l’entreprise et en dehors d’elle-même, et sans le bénévolat, elle ne pourrait pas grand-chose. A commencer par les lois, les mœurs, les valeurs collectives, la morale ambiante etc.
Encore l’entreprise, à travers le bilan, cherche au moins à évaluer son patrimoine physique, et parfois commercial (goodwill). Mais au niveau national, rien de tel. Comme beaucoup l’ont fait remarquer, si je brûle une forêt et que je replante, le PNB augmente. Mais évidemment la communauté est appauvrie. Il faudrait donc calculer le stock de patrimoine collectif, naturel (environnement, terroirs etc.) ou humain (routes, maisons etc.) ou au moins ses variations pour en affecter le PNB. Mais bien évidemment, même cela laisserait de côté le patrimoine culturel, moral, sociologique etc. qui fait vivre la société et lui donne son sens. La désagrégation de la famille, source de malheurs multiples, fait sans doute augmenter le PNB à terme proche. A la charnière des deux, on trouvera le patrimoine au sens étroit du terme (monuments etc.), dont on peut calculer une valeur, mais qui en réalité vaut bien plus.
Il est donc vital d’élargir le regard et de prendre en compte non seulement l’importance cruciale de ces éléments, mais qu’eux aussi sont pour nous une forme du don : nous ne les avons pas créés, et le fait de les recevoir implique une forme de dû, comme dans l’enchaînement des dons et contre-dons. Je parle de dû plus que de dette comme certains le font, car le terme dette tend à suggérer une réponse sous forme de devoir calibré, de prescription. Or bien souvent la réponse appropriée sera de notre part un contre-don plus que le paiement d’une dette.
Conclusion
Nous avons évoqué le rôle essentiel du don dans la vie sociale, dans la création du lien social. Il apparaît notamment dans cette communauté de base qu’est la famille. A bien des points de vue, ce n’est pas l’individu qu’il faudrait prendre comme unité de base, mais la famille. La pauvreté comme la richesse se vivent en famille. Et ce qui émerge particulièrement dans le cas de la famille, c’est qu’elle est le lieu du don.
Mais si le don est aussi essentiel, notamment dans la formation de la société, quelle est la place du calcul ? Calcul fondé, rappelons-le, sur la notion de rareté. Plus exactement, comment faire cohabiter une dimension de calcul et une dimension de don ? Prenons l’exemple du travail : ce que fait par exemple la mère de famille à la maison est évidemment un travail, et cependant il n’est pas rémunéré (voir sur ce sujet www.pierredelauzun.com/Le-trou-noir.... Mais en même temps, il n’est pas évident qu’une rémunération répondrait pleinement à ce souci, par exemple sous forme d’un salaire domestique versé par la société ; en effet, même si c’est bien sûr justifié, cela ne sera pas commensurable au service rendu, à l’apport véritable. Cela aurait l’avantage de faire prendre conscience de la réalité économique de cet apport, et de le traduire concrètement, tout en aidant les intéressées ; mais sans prétendre régler la question de la reconnaissance qui leur est due. Car une gratuité reste une gratuité, à reconnaître comme telle. Sans exclure en aucune manière une telle rétribution, il faut donc aller plus loin dans l’analyse.
Au fond, dans toute société chacun doit travailler, au sens large du terme travail. Et d’abord travailler au profit de la communauté où il vit. Certaines de ces prestations, de ces formes de travail, entrent dans la sphère marchande ; d’autres non ; d’autres enfin sont imposées par la loi. Mais en même temps, il faut qu’il y ait une forme d’équité dans ces échanges de différents types : il faut que le travail de tous, sous toutes ses formes, soit à la fois reconnu et rétribué. Où cela peut-il se faire ? Evidemment dans ce qu’on appelle communauté, qui comporte à la fois une autorité, des échanges marchands, et des dons ou une forme de gratuité. Cela commence avec la communauté de base qu’est la famille. Chacune doit y avoir de quoi se procurer ce qui relève de la sphère marchande (travail salarié de certains de ses membres, complété par des prestations publiques ou solidaires) ; mais aussi reconnaître et encourager le travail rendu, d’abord en interne, et aussi en externe dans le cadre de communautés plus vastes. Car c’est dans la communauté que se situe la gratuité, et sa reconnaissance possible comme élément vital de la vie commune. Il y a donc un lien étroit entre la reconnaissance du rôle de la communauté, celle de la contribution du don, et la construction du lien social. Non pour éliminer l’échange marchand, parce qu’il est très souvent indispensable, notamment dès que la relation avec l’autre n’est pas un lien de vraie communauté ; ni d’ailleurs la coercition, l’autorité publique, pour des raisons analogues. Mais pour souligner qu’ils sont tous deux limités et relatifs. Ajoutons que ceci rejoint les considérations plus générales sur la relativisation de notre rapport à l’argent, aux biens matériels, et à la consommation. Dans une large mesure, c’est la même question.
Au-delà de la famille, ces considérations valent aussi pour des communautés plus larges, de façon adaptée. C’est notamment vrai de l’entreprise, qui appartient certes d’abord à la sphère marchande, mais où des éléments de gratuité, de don doivent être présents comme on l’a vu et comme le rappelait avec force Benoît XVI dans Caritas in veritate. En témoigne aussi le bel exemple de ces entreprises qui décident de modifier leur culture collective pour organiser systématiquement l’emploi de handicapés ou d’exclus, en les intégrant à part entière dans le processus de travail. Cela contribue à créer un nouveau rapport social, et bénéficie d’ailleurs de ce fait à l’entreprise elle-même. Donc à agir par gratuité, comme une forme de communauté, y compris dans le cadre d’une entreprise commerciale. Simultanément, la science économique devrait enfin prendre en compte ces formes de travail donné, qui constituent une part essentielle de la véritable économie humaine.
Au niveau de la société prise dans son ensemble, les mêmes exigences se retrouvent ; mais il faut alors en admettre aussi les limites. Certes, alors, la notion de communauté peut et doit subsister, mais elle est plus loin des personnes. Dès lors, le lien marchand et la coercition étatique y dominent ; cela peut conduire certes, et légitimement, à des formes de solidarité imposée, mais ce sera avec moins de création de lien social. C’est là que l’on perçoit tout le sens du principe de subsidiarité. Car c’est à la base que le lien se crée. Et donc le devoir premier de la communauté large, nationale, est de favoriser les communautés proches, et le sens de la communauté partout où il est possible. Là où se trouve la gratuité.
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Imprimer
Imprimer