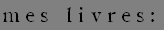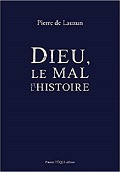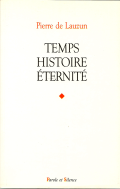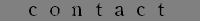
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
L’écologie : un problème pas si simple (premier de 3 articles)
vendredi 8 juillet 2022
Nous sommes désormais tous acquis, ou presque, à l’idée que le souci de l’environnement, l’écologie, sont des exigences majeures et incontournables. Là où cela se complique, c’est dans l’analyse du mal, et surtout dans la portée et la nature des mesures à prendre. Déjà, toute analyse des questions écologiques comporte par nature une dimension scientifique importante, afin de mesurer où sont les problèmes, les enjeux réels et les solutions possibles - qu’il s’agisse du réchauffement, de la pollution sous toutes ses formes, de la disparition des espèces ou de l’épuisement des ressources. Mais en l’espèce comme ailleurs les consensus scientifiques n’existent pas toujours, et quand ils existent, ils peuvent s’avérer contestables sur la durée. Bien entendu, il faut quand même prendre position, et vu la nature de ces problèmes cela peut conduire de façon légitime à des remises en cause importantes de notre vie personnelle ou collective. Mais il est également légitime qu’il y ait plusieurs positions possibles. Comme telle, cette analyse scientifique dépasse le cadre de cet article, tout autant que l’examen des solutions techniques à apporter aux problèmes soulevés.
Cela dit, une partie appréciable de ces constatations n’est réellement contestée par personne, et demande déjà une réaction énergique et de grande ampleur. Il y a une pollution massive et elle est nuisible pour nous et pour la planète ; il y a une réduction dangereuse de la diversité des espèces ; et il y a au moins à terme une perspective d’épuisement ou de raréfaction de ressources non-renouvelables essentielles (minerais, énergies fossiles etc.), ce qui impose de ne pas les surconsommer et de rechercher des ressources alternatives. La question plus controversée, au moins par une minorité réduite mais active, est celle du rôle de l’homme dans le réchauffement climatique. Mais d’une part il y a un réchauffement peu contestable, et l’humanité devrait au minimum contribuer à ne pas l’aggraver ; et d’autre part la grande majorité des spécialistes conclut à l’origine humaine (‘anthropique’) de ce réchauffement. Par ailleurs, les mesures permettant de lutter contre le réchauffement, notamment les économies d’énergies ou le recours à des énergies plus durables, seraient justifiées même s’il n’y avait pas ce réchauffement ou s’il était naturel.
Cela dit, le débat subsiste sur l’urgence, l’ampleur et la nature de ces actions. C’est qu’il n’y a pas un pur débat scientifique ou technique, puis des mesures qui s’en déduisent de façon indiscutable. En réalité, la question concerne la société dans son ensemble, sur les plans politiques, économiques et sociaux. Elle porte en effet sur l’ampleur et les modalités des évolutions possibles dans une société donnée, qui la feraient vivre autrement, dans un sens conduisant à des rapports meilleurs, tant à l’intérieur, entre ses membres, qu’avec son environnement naturel. Or une société réelle est composée de millions de personnes autonomes, ayant leurs vues et leurs priorités, entretenant des rapports mutuels socialement encadrés mais complexes et multiples. On ne peut pas planifier à l’avance ce que doit faire une telle société et où elle doit aller. On peut agir en diffusant des idées ou des références nouvelles, en proposant des modèles alternatifs d’action pour ses membres, ou en agissant sur les lois et règlements, sur les politiques publiques ; mais il n’y a pas de méthode sûre pour obtenir un résultat posé à l’avance. Il s’agit de processus à initier et à accompagner, nécessairement multiples et diffus, et dont les effets seront en partie imprévisibles et incontrôlables. Or trop souvent la réflexion écologique raisonne de façon univoque, supposant qu’une fois ses conclusions adoptées, la société doit être alignée purement et simplement sur le plan d’action qu’elle a défini. Non seulement ce n’est pas désirable, mais c’est inefficace et contre-productif. Et ce l’est d’autant plus que les exigences posées par les ‘écologistes’ sont loin d’être exemptes de préjugés divers, notamment politiques.
Il reste que dans le champ écologique des hypothèses alarmistes sont avancées, qu’on ne peut se dispenser d’aborder ; car si elles se vérifiaient, les conséquences seraient démesurées. Il faut donc les examiner, sans absolutiser des affirmations qui au niveau scientifique peuvent n’être que des hypothèses, d’autant qu’on ne peut prétendre que la science nous donne toujours des certitudes, ni qu’elle soit immuable ou infaillible.
En résumé, on est donc pris entre un risque qui peut être très élevé, donc effrayant, et la réalité des sociétés humaines, qui ne se pilotent pas comme un véhicule. Et donc, si l’écologie pose des questions à la fois pratiques et philosophiques considérables, et si l’action est nécessaire, ses modalités et son ampleur sont moins évidentes.
Retour à quelques principes
La question centrale spécifique à l’écologie, plus que le seul environnement, est celle de notre rapport à la nature et de sa durabilité. Quels devraient être les objectifs de l’humanité en la matière ? On rappellera la définition du ‘développement durable’ dans le rapport Brundtland de 1987 : « assurer les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Mais ce n’est pas la seule préoccupation : il faut y ajouter par exemple le souci de la biodiversité, ou celui du respect de la nature, ou même de la beauté du résultat obtenu. Sur quoi se fondent ces soucis ? A l’évidence, pas uniquement sur des considérations économiques. Bien sûr, on peut donner de solides arguments économiques en faveur d’un tel ‘développement durable’. Mais une protection de la nature qui serait basée sur le seul intérêt économique serait bancale. C’est l’approche qu’on appelle utilitariste, qui ne se réduit pas au courant du même nom. Mais elle ne dit pas quels devraient être les objectifs des personnes et des sociétés ; elle pose au départ l’idée qu’ils les définissent librement, et que le seul objet de l’économie, et plus généralement de l’action commune, est d’agencer ces volontés individuelles au mieux. Dans cette perspective, une réflexion écologique, une idée de développement durable se réduisent à une question technique. Mais du coup, on fait l’impasse sur la réflexion commune concernant les critères qui doivent nous mouvoir, sur la définition de ce qu’il est bien de faire, et sur les motivations. D’ailleurs pourquoi se soucier des générations futures, qui, rappelons-le, ne sont par définition pas présentes, ou en enfance, et ne participent pas à l’interaction actuelle des personnes ? Pour l’utilitariste, cela n’a pas d’intérêt. La question centrale est donc au contraire la considération éthique : la recherche de ce qu’il est bien et bon de faire.
Mais la question de nos devoirs moraux envers les générations futures est elle aussi complexe. En termes simplifiés, selon la perspective que j’appelle classique et que je retiens, il s’agit de reconnaître qu’il y a une valeur intrinsèque aux choses, qui s’oppose à la pure valeur instrumentale, et qu’il y a pour nous un devoir à ce que les êtres se perpétuent au mieux à l’avenir afin d’atteindre leur plénitude, autant que cela sera possible. Car tous les êtres ont une forme ou une autre de finalité, qu’il faut respecter, et qu’on appelle leur bien. En outre, les êtres pensants (les hommes en l’espèce) ont une finalité propre, donc une valeur et une dignité spécifique et supérieure, mais aussi les responsabilités correspondantes. Cela veut dire que le souci écologique n’atteint sa pleine signification et son plein développement que dans le cadre d’une conception éthique, en dernière analyse fondée sur l’idée d’un bien objectif, pas toujours connu à l’avance ni même facile à déterminer, mais posé comme objectif commun.
Dans ce contexte, y a-t-il un droit égal pour tous de vivre et de s’épanouir ? Sûrement pas entre hommes et animaux, ou a fortiori entre eux et les autres êtres : la hiérarchie des êtres existe et doit être respectée. Et l’écologie décrit précisément un monde d’interactions qui forme système, où chacun a sa place, et où ces places ne sont pas définies arbitrairement, mais s’inscrivent dans la logique d’ensemble, selon le rôle et la finalité de chacun. Mais cela ne donne pas tous les droits à l’homme, bien au contraire. Ses droits sont subordonnés à sa mission. Mission qui est centrale, car il est le seul à penser le système, et à se définir ou plutôt se reconnaître un rôle consciemment. En même temps, le respect dû aux individus de toute nature atteint sa limite dans le fait qu’ils ont tous à disparaître un jour. Il y a donc un devoir de maintien des espèces et des équilibres naturels, mais pas un droit de chaque être individuel à être préservé : le respect qu’on lui doit est un respect relatif, puisqu’il est de toute façon appelé à mourir. De ce point de vue, la non-violence absolue de certains courants actuels est non seulement irréaliste, mais éthiquement non fondée, car une exigence morale doit partir de la réalité des choses ; il ne s’agit pas de plaquer un système moral abstrait sur les êtres réels, mais d’agir au mieux dans le sens de leur bien objectif.
Des dilemmes nombreux et complexes
Ainsi résumés rapidement, ces principes débouchent sur des dilemmes redoutables. Derrière son apparence simple, le concept même de développement durable ou même de durabilité est complexe, et susceptible de lectures multiples. Et cela même si on se limite à des considérations concrètes et factuelles. Que veut dire développement ? Que veut dire durable ? Quelles hypothèses pouvons-nous faire sur le futur ? Le consensus ambiant sur l’idée de durabilité s’accompagne en fait d’une faible conscience de sa complexité interne, et de ses conflits avec d’autres objectifs. La durabilité implique par exemple le souci des générations futures. Mais que signifie une telle solidarité intergénérationnelle ? Rendre à chacun son dû ? Mais sauf en termes généraux, comment définir et gérer précisément un dû envers des gens qui n’existent pas encore ? Le nombre même de personnes concernées par un tel précepte est aujourd’hui inconnu : comment donc analyser ce que nous leur devons ? S’agit-il de donner les mêmes chances que nous aux générations futures ? Mais quelle en est la portée dans le temps ? Jusqu’à la fin des temps ? Est-ce praticable ? Rawls parle de deux générations ; mais pourquoi deux ? S’y ajoute surtout notre ignorance des besoins du futur et des priorités qui seront celles des générations futures, et des capacités dont ils disposeront, notamment techniques. En fait, nous n’avons aucune idée précise de ce que sera leur monde – en dehors des données permanentes sur l’homme et la nature.
Un moyen d’essayer de s’en tirer est d’être maximaliste. On vise alors à laisser aux générations à venir la terre comme on l’a trouvée - ce qu’on appelle la ‘durabilité forte’. On peut la résumer comme suit : on ne tire pas de la nature plus de ressources qu’elle n’en régénère ; on ne rejette pas plus que la nature ne peut absorber ; si on utilise des ressources non renouvelables, on crée des substituts pour les générations suivantes ; le rythme de l’emprise humaine doit s’adapter aux rythmes de la nature ; la production d’énergie et de produits doit s’effectuer à un niveau sans risques. Dit ainsi, c’est séduisant. Mais même en mettant de côté l’acceptabilité politique de ce programme, qui est très faible, il débouche sur une économie dont la viabilité n’est pas évidente, et techniquement stagnante ou régressive. Or l’histoire avance, et le progrès scientifique et technique change les conditions du débat en permanence. L’application de ce principe en 1800 par exemple, avec le savoir de l’époque, aurait donné des résultats qui pour la plupart des gens, avec nos yeux d’aujourd’hui, auraient été aberrants et malthusiens.
La même complexité apparaît lorsqu’on évoque l’application de ce même concept de développement durable en temps réel, entre les différentes parties de l’humanité. La solidarité globale par exemple, qu’on met en avant non sans motif, veut-elle dire un droit identique pour chacun aux ressources globales disponibles ? Mais cela se heurte aux inégalités naturelles de ressources selon les pays, qui sont un fait. Et dans la pratique, on se trouve face à une liste complexe de questions qui se posent de façon très différente selon les pays : émissions de gaz, droits de pêche, maintien des sols, forêts, disponibilité en eau etc. S’y ajoutent les questions de solidarité liées au changement climatique. Doit-on donner des droits plus élevés aux plus pauvres ou aux plus faibles, comme certains le recommandent ? On nous dit qu’il existe un consensus moral fort sur le principe du maximin de Rawls (prendre comme critère la position des plus défavorisés, pour la maximiser, c’est-à-dire la rendre la meilleure possible) ; cela permettrait de lutter dit-on contre la dimension ‘sacrificielle’ de l’utilitarisme (lequel accepte qu’il y ait des perdants sacrifiés si la grande majorité s’en trouve bien). Mais ce consensus reste entièrement à démontrer, en pratique comme en principe. Il est en outre peu rationnel de juger de la moralité d’ensemble d’une situation en ne prenant comme critère que la situation particulière d’un petit nombre, même méritant une attention prioritaire. Croit-on en outre sérieusement pouvoir mettre les ressources pétrolières de la péninsule arabique au profit des masses africaines ? Certes, ce serait en théorie plus ‘juste’, mais c’est irréalisable.
De façon analogue, la question met en lumière l’insuffisance du vocabulaire qui s’exprime en termes de ‘droits’. Parler des droits de la nature ou des droits des générations futures n’a pas de sens pratique. En réalité, ici comme ailleurs, le seul vocabulaire qui a vraiment un sens est celui des devoirs : nos devoirs envers la nature, envers les générations futures etc. S’agissant des plus démunis, face à une menace commune à tous, il y a effectivement un devoir à se préoccuper plus particulièrement de ceux qui sont plus exposés à ce danger, et qui ont moins de moyens pour lutter contre. Le principe ne paraît pas faire de difficulté sous cette forme. Mais dans la pratique, qui a quel devoir concret, envers qui, comment, pour quel résultat ?
Nous constatons donc ici un fait majeur : en matière écologique comme dans les autres réalités humaines, au niveau collectif, même quand l’exigence morale est claire et peu discutable dans son principe, sa mise en œuvre et sa portée le sont beaucoup moins. Cela suppose des choix difficiles, personnels mais surtout collectifs, largement politiques. Même si on supposait l’analyse scientifique unanime dans chaque cas, ce qui est loin d’être le cas. Il n’est donc pas étonnant que ce qu’on constate dans la pratique est que le développement durable si souvent évoqué n’a pas encore, à ce stade, de rôle véritablement central dans notre vie réelle, ni au niveau intellectuel, ni dans l’action – même si la prise de conscience est indéniablement rapidement croissante et produit des effets ici ou là, pas toujours heureux d’ailleurs.
La dimension politique, essentielle
A ces interrogations s’ajoute le fait qu’il y a une difficulté majeure à appréhender collectivement les problèmes environnementaux. Déjà parce que nous avons besoin de la science pour déterminer certains effets de nos actions ; or en général, nous ne maîtrisons pas par nous-mêmes ces données scientifiques complexes, en supposant même qu’elles soient suffisantes et fiables. Mais plus radicalement, une difficulté plus spécifiquement politique provient de la nouveauté du défi et de sa nature même : la menace est peu visible, souvent à long terme et globale ; elle a une assez grande inertie, et elle est plutôt imprévisible dans ses modalités précises. Même dûment sensibilisés, il nous est par exemple souvent impossible de prévoir l’effet futur d’une molécule ou d’un produit nouveaux, ou d’une pratique, avant leur dissémination. Or ils peuvent créer des effets irréversibles. L’adage : ‘gouverner c’est prévoir’ est donc sur ce plan pris en défaut.
La difficulté est encore accrue si on se situe dans un cadre démocratique : d’un côté donc la population n’est pas en position de vraiment pondérer les problèmes ; et de l’autre on lui demande un effort extrêmement important, car a priori il y a contradiction entre ses modes de vie actuels et ce qu’il faudrait faire. Le risque est alors la monopolisation du discours par certains et l’exclusion des autres ; mais sans que cela empêche ces derniers de refuser les injonctions et de garder leurs modes de vie. Or le développement durable, plus exactement la conception particulière que certains s’en font, peut lui aussi devenir un tel discours en surplomb, et motiver un comportement brutalement autoritaire. Beaucoup voient d’ailleurs avec William Ophuls une contradiction entre démocratie libérale et rareté écologique. Selon lui, une société écologiquement complexe et stationnaire a besoin de ‘mandarins’ écologiques ; même une démocratie écologique saine a besoin d’une forme d’aristocratie, pour concevoir la politique à la lumière de l’écologie. Sortir de cette contradiction implique, dit-il, le besoin d’une religion civile – elle aussi avec ses grands prêtres. Mais outre qu’on voit mal ce genre de pouvoir s’instaurer, sauf grande catastrophe, et que ce n’est pas très alléchant, ce n’est a priori pas le moyen le plus sûr d’instaurer de vrais comportements respectueux de la nature dans les populations. Il y a donc ici un dilemme majeur. D’autres au contraire espèrent, avec bien des écologistes politiques, qu’on peut se baser sur une démocratie de base, grâce à un débat large et décentralisé. Mais, de façon générale, l’efficacité d’un tel débat reste à démontrer, surtout dans un contexte relativiste comme le nôtre - sans anthropologie commune, et avec une forte tendance de l’opinion à se fragmenter en tribus antagonistes (effet accentué par les réseaux sociaux). En outre et surtout, en l’espèce les résultats peuvent être tout à fait antiécologiques. Notamment du fait que les générations futures, les plus concernées, ne participent par définition pas à ce débat et ne votent pas.
Les dilemmes et questions de principes sont donc très nombreux et nullement résolus. Remarquons cependant que rien de tout cela ne fait disparaître l’exigence de responsabilité envers ces questions où l’avenir de l’humanité peut se jouer, ainsi que de solidarité. Mais cela implique que la mise en œuvre en soit tout sauf évidente, surtout si on prend la question au niveau global. En fait, seule l’exigence morale générale est dans son principe claire et indiscutable. Sa mise en œuvre suppose une analyse de situation, variable cas par cas, et dont les conclusions ne vont souvent pas de soi. Les grands anathèmes appréciés par certains et les concerts de cris catastrophistes n’y changent rien. A nouveau, une mutation d’ensemble de la société ne se décide pas purement d’en haut, selon un plan prévoyant à l’avance les modalités pratiques d’action. Et si des mesures d’autorité sont évidemment nécessaires, la voie la plus efficace, dans une grande majorité de cas, sera au niveau local, chacun y prenant ses responsabilités, personnellement ou en communauté.
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Imprimer
Imprimer