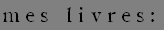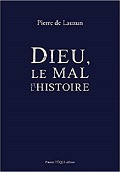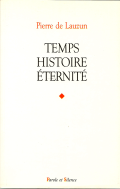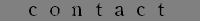
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
La Chine et la démocratie
samedi 27 février 2010
Une conclusion qui n’est pas donnée d’avance
(Lecture de La Chine et la démocratie publié sous la direction de Mireille Delmas-Marty et Pierre-Etienne Will Fayard 2007).
La question de la démocratie en Chine est un enjeu majeur, d’autant que le régime continue avec assurance dans sa voie, fort de ses succès économiques. Sans donner une réponse univoque, ce gros livre collectif est une mine d’informations sur ce thème, bousculant un certain nombre d’idées reçues.
L’héritage impérial
Au départ, il est intéressant de se remettre à l’esprit les réactions à la démocratie de fonctionnaires chinois au XIXe : ils la voyaient comme une forme de corruption et un refus de tout intérêt général, une somme d’intérêts privés, matérialistes ou opportunistes, et dominée par l’argent. Comment d’ailleurs donner le droit de vote à tous, alors qu’il y a des différences évidentes entre les hommes selon la qualité éthique et le savoir ? En outre, l’éducation et la vertu sont réclamées du haut fonctionnaire et « sont les seules garanties possibles d’objectivité, d’impartialité et de défense des intérêts supérieurs de l’Etat et donc du peuple ». Cette vision reste prégnante dans la Chine actuelle : l’idée est répandue qu’il faut confier le pouvoir à une élite éclairée et non à des ignorants ou des businessmen ; « une gestion compétente et sérieuse, attachée aux vrais problèmes et libre de toute entrave politicienne ». Dans le confucianisme, une préoccupation essentielle est de savoir quel est celui qui est le plus apte à gouverner, et comment le préparer ; on compare en permanence la relation d’autorité publique à la relation parents/enfant. Il faut souligner la faible importance de la revendication égalitaire, même après 1911. L’idée ‘un homme une voix’ paraît étrangère. Même l’éducation de masse est là non pour donner l’autonomie, mais pour faire émerger des individus d’élite.
En même temps, dans de nombreux préceptes et règles de l’époque impériale on trouvait un principe profondément intériorisé qu’on peut appeler en un sens d’égalité (pas de classe privilégiée) : dans les examens, dans le code pénal, dans la fiscalité. On le trouve aussi dans le fonctionnement de nombreuses associations et guildes, avec des responsabilités données à tour de rôle à chacun et des élections, ou dans l’importance des leaders villageois, des associations et confréries en milieu urbain. Plus généralement coexistait un encadrement administratif plutôt léger avec un encadrement idéologique et culturel très important, imprégnant toute la société, et c’est par lui que se faisait le lien entre la légitimité politique et les formations sociales locales. On avait aussi une tradition bien établie d’opposition populaire aux excès du pouvoir bureaucratique, une sorte de droit de remontrance ou de protestation, notée par tous les observateurs étrangers ; on avait même des réunions de protestations notifiées à l’avance, sans parler des affiches. On peut y ajouter la capacité à résister aux impôts, constatée par les mêmes observateurs : « le peuple chinois décide lui-même de ses impôts » (Giles) ; ils étaient d’ailleurs faibles et stables. Il faut enfin noter le taux d’alphabétisation alors relativement élevé : 30 à 45 % des hommes. On baignait dans un univers d’écrits ; tous les villages avaient une école primaire. Le sentiment du peuple était en outre le principe de légitimité ultime, dans la tradition confucéenne interprétée à travers Mencius, avec la notion de « mandat céleste » fondant la légitimité de chaque dynastie mais révocable. Mais cela ne minait en rien les fondements de la monarchie chinoise et son autorité imperturbable.
Contrôle bureaucratique et juridique
Il faut souligner d’abord le rôle du Yuan de contrôle (censorat), organe majeur de l’administration impériale, avec censure des fonctionnaires et contrôle des comptes, idée reprise par Sun Yat-sen. Il s’agit bien de la vérification par un organe de la conformité des actes avec une norme. Sous les Ming ces censures étaient publiques, et ont fait l’objet d’une exploitation politique. Mais il n’y avait pas de juge administratif : la critique passait toujours à l’intérieur de l’administration ; le censorat était supposé agir de sa propre initiative et formellement ne pouvait être saisi. Le nombre de ces censeurs était très réduit mais tous les documents passaient entre leurs mains. Ni l’empereur ni l’administration ne pouvaient normalement agir de façon totalement arbitraire. Il y avait disaient les missionnaires ‘suprématie de la loi’. En fait c’était plus compliqué, car les règles étaient multiples et souvent inapplicables. En outre, si un édit avait par définition valeur légale, on pouvait aussi lui opposer une résistance bureaucratique somme toute assez efficace. Comme référence, il y avait d’abord les Classiques, corpus intangible et sacralisé, supérieur à tout texte produit par les dynasties subséquentes ; ils fondaient un certain pouvoir intellectuel des lettrés. On avait ensuite « les institutions des ancêtres »de la dynastie, corps de références variant à chaque dynastie. Et enfin la masse de textes divers. Mais pour les censeurs l’essentiel relevait de la règle morale : l’intention, la ‘sincérité’ des administrateurs, dans la tradition confucéenne. Il n’y avait d’ailleurs pas d’Etat à proprement dit : on ne pouvait s’en prendre qu’à des personnes. Et on ne pouvait pas censurer l’empereur. On pouvait respectueusement critiquer son comportement et lui adresser des reproches, notamment au nom des Classiques, ou lui opposer les institutions dynastiques, ou les ‘modèles anciens’, même si cela n’avait pas valeur juridique directe. On opposera ici la situation sous les Ming (critiques parfois féroces de l’empereur Wanli) et sous les Qing mandchous (peu ou pas de droit de critique).
Dans le cas du pénal, le principe de légalité des délits et des peines est peut être une invention chinoise, car il y remonte aux Tang, soit avant l’an mille., alors qu’il n’était que latent avant le XVIIIe siècle en Europe. En Chine, la clarté sur la loi et les peines était proclamée ; en revanche il n’y avait rien sur les libertés et droits, mais nous dit-on cela n’a pas empêché le système d’être ‘juste et prévisible’. L’idée est présente depuis Confucius : la clarté sur les châtiments éclaire le peuple. De fait, le droit en Chine était publié et largement vulgarisé. La technique juridique était d’avoir un cadre général de lois, appelées ‘lü’, et une mise en œuvre plus précise par d’autres lois, les ‘li’. Il n’y avait pas de rétroactivité sauf si elle profitait à l’accusé. La règle de droit comme syllogisme, concept développé par Beccaria, se trouvait constamment appliquée en Chine sur le plan judiciaire - contrairement à l’idée répandue que le syllogisme leur est étranger. Mais il n’y a avait aucune référence de droit alternative à la loi, comme la coutume : la seule loi est publique et bureaucratique. Et pas de droit civil (mais nous dit-on a-t-il joué un rôle dans le passage à la démocratie ?) On constate même l’émergence d’une communauté de juristes à la fin de l’Empire ; c’est la parution du code impérial de 1740 qui l’a fait émerger. Il donnait primauté à la loi vivante, la plus récente, avec un mécanisme d’intégration des nouvelles lois tous les 5 ans et de refonte tous les 10 ans.
L’expérience de la démocratie au XXe siècle avant le régime communiste Le livre fait un examen complet des tentatives diverses de république entre la chute de l’Empire en 1911 et l’arrivée au pouvoir des communistes. La singularité de la Chine est dans la présence dominante après 1911 de l’idée reçue qu’il fallait absolument une révolution culturelle, une rupture complète avec le passé, notamment du fait de l’irruption des idées occidentales. L’analyse d’Yves Chevrier est qu’il y avait eu au contraire une évolution réelle, interne au système chinois, qui potentiellement intégrait la modernité sans rupture avec l’Empire, et débouchait sur un Etat-nation. Mais elle a échoué politiquement (contrairement au Japon), et c’est pour cela qu’il y a eu ensuite volonté de rupture. On insiste trop souvent dit-il sur l’idée que l’occidentalisation était superficielle et que cela a conduit à un saut inévitable vers un nouvel universalisme, révolutionnaire. En réalité il y a eu politiquement, et à l’intérieur du pays, un mouvement nationaliste réformateur ou radical. Mais mal géré notamment par la dynastie, il a conduit à sortir de façon désordonnée de l’Empire. Notamment, ce n’est pas la ‘nation’ qui excluait la dynastie Qing ; mais elle qui s’en est exclue en s’opposant aux notables et à la société civile. Or faute du support impérial la maturation était impossible. L’Empire avait eu une forme d’institution inégale et partielle de la société civile, par des moyens non-politiques, que la république a échoué à construire avec des moyens neufs. Dès lors la dimension politique l’a emporté mais sur le mode de l’illusion, jusqu’au maoïsme. La sortie de l’Empire s’est faite au profit d’un activisme destructeur et non d’une institutionnalisation et construction de l’Etat, qui en fasse le garant des droits des individus. On a le même problème aujourd’hui. « C’était autour du titre impérial et de la fonction qu’il représentait que s’organisaient la politique, la vie sociale et la culture en Chine. Comment, dès lors, reconstruire le politique au milieu du vide laissé par la disparition de ce même titre, et qui plus est en pleine modernisation ? » « Dans la plupart des cas c’est le discours sur le despotisme éclairé qui a dominé, sous des formes variables, la pratique politique jusqu’au moment de la prise du pouvoir par les communistes ». Ce rejet du compromis culturel du début du siècle était aussi rejet du confucianisme. Ce stade est aujourd’hui dépassé, mais il reste le mythe d’une contradiction entre la culture chinoise et la démocratie.
On a donc eu une longue phase d’illusion lyrique comme en France en 1848, à dominante révolutionnaire, phase dont on n’est sorti que vers 1990. On exaltait l’autonomie des sujets sans penser la construction institutionnelle de leur liberté. Les équipements institutionnels de la démocratie réelle étaient absents, non seulement de la réalité, mais des concepts. On s’occupait beaucoup d’Etat et de pouvoir, mais dans une violence symbolique, sur un terrain en fait culturel plus que politique. Etre démocrate n’avait plus rien avoir avec des élections ou des militants : c’était se libérer et agir pour la liberté des autres. On imaginait un social qui se construise sans instrument politique et sans contradictions. Ce qui émergea est un Etat qui n’avait pas acquis son autonomie, sa neutralité institutionnelle : l’Etat politisé de la révolution. Le régime de Nankin (le Guomindang alors encore sur le continent) était lui aussi celui d’une révolution avortée, qui restait tributaire de la pensée révolutionnaire du nationalisme chinois tel qu’il s’est alors construit. C’était sa marque originale, très différente du processus de reconstruction et de mobilisation du passé avec invention de la tradition auquel ont procédé les nationalismes non révolutionnaire. Il n’y a eu dès lors aucun conservatisme structuré. Ce n’est donc pas la tradition qui s’est opposée à la démocratie, mais l’échec d’une politique moderne qui a compromis l’idéologisation conservatrice. Cela se fera bien après et à Taiwan. Sur le continent la facette autoritaire domine toujours ; l’institutionnalisation de la liberté y prend la voie du droit, faute de pouvoir ouvrir celle de la démocratie.
L’évolution du régime communiste
Aspects politiques et idéologiques
Il existe toujours au sein du parti une fraction qui estime que le socialisme doit être démocratique, même si elle ne domine pas. A usage externe, le régime ne s’oppose pas ouvertement à la démocratie et aux Droits de l’Homme, mais explique que cela suppose développement et adaptation aux caractéristiques chinoises. A usage interne en revanche ce qui l’emporte est la propagande marxiste et nationaliste, et la critique des systèmes politiques occidentaux. « L’évolution politique de la Chine depuis les deux échecs de 1979 et de 1989 semble montrer une détermination du pouvoir à empêcher systématiquement que les réformes économiques ne débouchent sur une authentique démocratisation du régime. » Le problème de la forme politique n’est toujours pas résolu. L’Etat est faible parce qu’il est dévoré par le Parti. « La Chine est dirigée par une institution, le Bureau Politique du Comité central, qui n’est cité nulle part dans la Constitution ».
Cependant, malgré les échecs une chose domine, nouvelle : l’idée de souveraineté populaire (zhuquan zai min) est considérée comme seul fondement légitime du pouvoir. Mais pour justifier la démocratie, deux tendances sont présentes : pour l’une, elle dynamise le peuple (mais cette thèse pèse peu face à la tentation du despotisme éclairé) ; l’autre la valorise en soi, dans une perspective qui peut être soit occidentaliste, soit traditionaliste (appel aux valeurs chinoises classiques revues pour l’occasion). Il existe donc de ce point de vue une tradition démocratique, et les intellectuels en sont les principaux acteurs. Mais leur rapport à la société reste ambigu : ils y apparaissent souvent comme des étrangers. D’où la tentation répétée du despotisme éclairé, comme de son pendant le populisme révolutionnaire. La nouveauté après 1980 est l’apparition du terme fazhi (légalité), utilisé la plupart du temps en binôme avec minzhu (démocratie). Elle ne vise pas la participation au pouvoir, mais l’Etat libéral, la légalité. D’où le retour des notions de droits de l’homme et de liberté de parole. Au-delà des idées, cette évocation est populaire car elle renvoie à l’expérience douloureuse de chacun, qu’ont été les années de maoïsme. Après la phase des années 80 qui portait sur la démocratie immédiate, la dominante dans les années 90 s’est donc déportée sur le libéralisme et le constitutionnalisme, et le terme de liberté l’emporte sur celui de démocratie.
Il est cependant difficile de créer un Etat de droit tant que le Parti communiste aura le dernier mot sur ce qui est ou n’est pas juste pour lui-même. Même les élections locales contribuent à la montée des pratiques démocratiques, mais sans remettre en cause la règle du parti unique : « les élections directes locales produiront une nouvelle légitimité pour le Parti communiste et contribueront à stabiliser l’ensemble du système plutôt qu’à l’éroder. Ainsi, le monopole du Parti communiste peut être et sera certainement renforcé pendant encore une longue période. » Ceci dit, « la qualité procédurale des élections villageoises s’est considérablement améliorée durant la dernière décennie. » Mais elles sont supposées s’opérer sous l’autorité du Parti. Le parti s’adapte donc et « essaie de renforcer son pouvoir monopolistique en introduisant graduellement plus de transparence et de démocratie procédurale dans les décisions internes en matière de recrutement de fonctionnaires locaux » ; il organise des élections en en conservant le contrôle, qui lui donnent un nouveau souffle ; « il n’y a pas de raison de croire que l’amélioration future des élections villageoises, voire l’introduction systématique d’élections cantonales directes, toujours sous la tutelle du Parti unique, doivent être considérée par la population comme autant de manipulations non démocratiques. »
A Taiwan en revanche, l’évolution démocratique s’est faite, après la croissance économique et sans impact négatif pour elle, et sans tensions sociales du fait des inégalités. Il y a eu en outre processus interactif entre les autorités et les forces de l’opposition. Peut-être le Guomindang avait-il surestimé son avantage de départ. En outre, les engagements du régime allaient en ce sens : l’idéologie de Sun Yat-sen diffusée partout débouchait sur une forme de capitalisme d’Etat, qui supposait une organisation de type démocratique. Une dimension importante a été l’idée que l’intérêt de l’île passait avant la reconquête désormais hypothétique du continent. Mais même là le processus reste partiel : le parlement est resté sous le contrôle du Guomindang (et maintenant à nouveau la présidence).
La question du droit
Le lien entre démocratie et Etat de droit paraît aller de soi en Occident ; mais la réalité est plus incertaine, dans le contexte postmoderne marqué par « l’incertitude, la complexité et l’indétermination », et où la mondialisation bouleverse les cartes. Dans ce contexte, le régime chinois ne conteste plus la légitimité légale et rationnelle de l’Etat de droit. On assiste même à un gros travail de rédaction voire de codification juridique, après le nihilisme légal de la Révolution culturelle. Certains espèrent une affirmation progressive des droits et de la séparation des pouvoirs par le jeu de la dynamique juridique. Le droit peut en effet être la seule voie praticable. Certes le système des assemblées est devenu une forme de caisse de résonance pour les doléances de la société chinoise ; mais la distribution des pouvoirs législatifs n’est pas claire. Certes aussi, professionnalisation et technicité jouent en défaveur du parti ; mais c’est compensé par la cooptation des talents qu’il opère. On constate l’influence croissante des experts et professionnels du droit dans les réformes. Les premiers enjeux sont le contrôle de la légalité des actes administratifs et celui de la constitutionnalité des lois. Mais il n’y a pas encore de vraie hiérarchie des normes. L’adhésion à l’OMC joue un rôle important pour faire aller vers un état de droit économique. Mais il faut prendre en compte le caractère morcelé et enchevêtré du pouvoir, et le gros problème de l’application uniforme des lois. On finit même par s’en remettre au Parti pour rechercher l’application uniforme des lois. De leur côté, les assemblées s’affirment mais ne peuvent pas rompre le lien avec le Parti, si bien que l’on peut se demander « si les assemblées populaires ne risquent pas de devenir essentiellement des armes légales que le Parti pourrait utiliser pour surveiller une bureaucratie plus différenciée et plus sophistiquée tout en enrichissant sa palette de contrôle idéologique et personnel ».
Mais il faudrait au moins une réforme suffisante pour qu’un système de contre-pouvoirs garantisse l’indépendance et l’impartialité de la justice face aux gouvernants. Il faut souligner ici les liens entre le parquet et le Parti, les privilèges judicaires des membres du Parti, les instructions directes données aux tribunaux par les dirigeants locaux, l’autonomie de la police, l’importance de l’insertion des magistrats dans le tissu de pouvoir local. D’où la tentation du centre d’y remédier en augmentant le rôle du Parti. Le résultat est variable selon la région et l’exposition à l’étranger. Par ailleurs un état de droit complet au sens occidental actuel supposerait les droits de l’homme, qui donnent la possibilité de s’opposer au pouvoir sur la base du droit, la primauté de l’individu dans l’organisation sociale et politique, l’instrumentalisation de l’État, et un droit qui dote chacun d’un statut, du pouvoir d’exiger et d’une capacité d’action. Ce n’est pas du tout le cas en Chine. Selon l’auteur, Etat de droit et démocratie ainsi compris sont deux principes consubstantiels. Mais d’autres comme Peerenboom croient à la possibilité d’un Etat de droit non démocratique, notamment en Chine.
Vue d’ensemble
On l’a vu, le principe de légalité existe bien à sa façon dans la tradition chinoise ; mais pas celui de garantie judicaire car il n’y a jamais eu indépendance des juges. Un dilemme central est le suivant : la notion de « gouvernement par les hommes » a été disqualifiée par la pratique maoïste ; mais c’est celle qui était valorisée par la tradition confucéenne, avec un sens évidemment différent. Peut-elle être complètement remplacée par le gouvernement par la loi, traditionnellement tenu en suspicion et réservé au pénal ? Dans la tradition en outre, justice et police sont dans les mains de l’exécutif et non de pouvoirs indépendants. Comment peut-il y avoir démocratie dans ce contexte ? Ce peut être nous dit-on par une « fécondation juridique du terrain politique ». Mais aussi par la référence traditionnelle à la primauté du peuple, voire un retour au précédent de l’expérience de débat relativement libre et critique sous les Ming tardifs, il y a quatre siècles... Il y avait en outre certainement un contrôle des abus de pouvoir par les fonctionnaires, par droit de pétition et censorat. Mais la notion même de société civile, floue à l’époque, n’est aujourd’hui toujours pas stabilisée. Quant à la question des Droits de l’Homme, la Chine n’accepte à ce stade ni la censure de la loi ni la condamnation de l’Etat. En résumé nous dit-on la modernisation a deux dominantes : autoritaire et libérale ; elle peut tout à fait déboucher sur un ordre juridique qui ne serait opposable ni aux acteurs publics, ni aux acteurs économiques. Et les dirigeants chinois de leur côté, acceptent la mondialisation économique, mais pas la politique, tandis qu’ils hésitent sur la juridique.
Nous dirons pour notre part en bref que la question de la démocratie en Chine paraît tout à fait ouverte. Evolution vers un régime plus complexe, civilisé, régulé : c’est possible voire, si on est optimiste, concevable si les tendances actuelles se poursuivent. Cela peut aller jusqu’à une démocratie formelle mais autoritaire, un paternalisme à la singapourienne. Mais une démocratie à l’occidentale ? Ce n’est apparemment pas à ce stade dans les cartes. Et si cela le devenait, tout pousse à croire que cela prendrait la forme d’un parti dominant, comme c’est le cas en fait à Taïwan et au Japon, sous une forme originale et sans doute plus contrôlée. Mais qui vivra verra…
Avril 2008
(Publié initialement dans Liberté politique)
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Imprimer
Imprimer