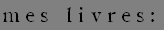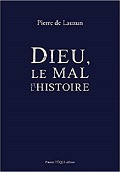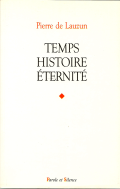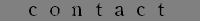
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
Société du bien-être et culture de mort
lundi 12 novembre 2012
SOCIÉTÉ DU BIEN-ÊTRE ET CULTURE DE MORT
Qu’entend-on donc par culture de mort ?
Parler de « culture de mort » pour notre époque évoque dans les esprits une image tragique, a priori bien éloignée de l’apparence tranquille de nos sociétés. On se demande alors quelle mouche a piqué Jean-Paul II et d’autres à utiliser cette expression à première vue choquante pour dénoncer une des dimensions de notre culture collective. Mais le paysage change dès qu’on évoque l’importance collective qu’a désormais prise la mentalité abortive, contraceptive, contraceptive, ou euthanasique, caractéristique de la société actuelle. Sans oublier ces manipulations tranquillement effectuées sur ces jeunes vies humaines que sont les embryons, qu’on appelle en l’occurrence surnuméraires pour bien souligner qu’on se passerait volontiers d’eux, sauf pour les manipuler dans nos laboratoires dans des opérations mortelles (non indispensables, comme on sait). Dans tous ces cas il s’agit d’agir consciemment pour éviter qu’une vie se développe, ou plus gravement encore, pour la supprimer.
Sans surprise, l’idée d’une culture de mort peut être étendue bien au-delà de la bioéthique. Car sur de nombreux points notre société manifeste depuis quelque temps une attitude hostile à la vie et une propension aux attitudes suicidaires ou meurtrières, dès que les conditions paraissent le justifier selon les idées du temps. On a vu cette attitude à l’œuvre dans l’histoire européenne du XXe siècle, en commençant par les guerres totales et les massacres de civils qui les caractérisent. Ces faits sont en effet sans précédent dans l’histoire. Cela vise bien sûr les grands massacres totalitaires communistes ou nazis ; mais ils étaient le fait de régimes pervers, désormais condamnés par tous. Que dire en revanche des bombardements massifs de populations civiles pendant la seconde guerre mondiale, visant consciemment et froidement à tuer le plus grand nombre possible de non-combattants, femmes et enfants notamment, en faisant régner la terreur ? Ils ont été pratiqués par les Anglo-américains : ceux qui bombardaient étaient donc des démocraties modernes ; et le fait qu’ils répliquaient à des régimes inhumains et coupables ne fait pas disparaître la gravité sans précédent du geste.
On pourrait rapprocher de cette notion de culture de mort le suicide démographique qui caractérise nos sociétés : que dire en effet d’une société qui n’accueille pas l’enfant et les générations futures comme un fait naturel bienvenu, mais organise les moyens d’assurer la limitation la plus étroite possible des naissances à qui le souhaite ? Là ce ne sont pas tant les politiques publiques qui sont en jeu que les choix d’une part dominante de la population, appuyés par des politiques tolérantes de n’importe quel comportement, déviant ou socialement destructeur ; notamment en Europe. On pourrait encore au-delà rapprocher de cette attitude le goût du morbide, évident dans les spectacles et les arts contemporains. Voire les sports et pratiques extrêmes lorsqu’ils admettent une prise de risque sans justifications, trahissant une fascination pour la mort possible. Symboliquement en effet, dans tous ces cas, c’est la mort qu’on cherche ou la vie qu’on évite, la vie qui dérange, notamment celle qu’on n’a pas planifiée.
Ce qui est globalement en cause ici est en effet une attitude d’ensemble par rapport à la vie. Elle n’est plus vécue comme donnée, depuis la conception jusqu’à son terme qui est la mort, et par là a priori bonne et respectable. Ni conçue comme tournée vers les autres, vers l’accueil des autres quels qu’ils soient, notamment les générations futures. Si on la valorise, c’est en la centrant sur soi-même : notre même époque dépense des sommes démesurées pour améliorer son confort ou son esthétique personnelle. Et même quand on ne refuse pas toujours ou explicitement la vie comme telle, on la pense faussement : on ne valorise en définitive que sa petite vie à soi, au plus celle des adultes qui décident, gratifiés du titre de citoyens. Mais une telle attitude est en réalité la négation même de la vie. Car en dernière analyse, au niveau terrestre on sait bien qu’on doit mourir. En ne se concentrant que sur sa propre vie on limite caricaturalement ce qu’est véritablement la vie, qui est don et prolongement et nous appelle donc bien au-delà de nous-mêmes.
Plus généralement bien sûr, on retrouve dans cette attitude ce qui est le paradigme central de notre société : cette idée folle qu’on peut et doit se faire sa propre morale à soi, se « choisir » ses « valeurs », comme cela nous plaît. Là encore il s’agit en définitive de se centrer exclusivement sur soi. Ce qui est la négation même non seulement de toute morale, mais comme on l’a vu de la loi même de la vie - et donc un choix de mort. Le relativisme dominant est en définitive au fond de lui-même une forme de culture de mort. Il y a donc sur ce plan un processus logique unissant l’ensemble des lois et des projets en cours, depuis la contraception jusqu’à l’euthanasie, et qu’on peut d’ailleurs étendre au mariage homosexuel et à la théorie du genre, qui l’un et l’autre refusent aussi certaines des lois de la vie.
Corrompre le langage naturel pour le neutraliser
Une des dimensions de ce processus est la subversion du langage, au sens étymologique du mot : retournement. Il n’est en effet ni facile ni naturel de proclamer frontalement une culture de mort. Et donc on va détourner le sens des mots, en priorité de ces mots qui désignent le processus de vie. On se souvient de ces grands romans qu’étaient 1984 d’Orwell ou Le meilleur des mondes d’Huxley : dans les deux cas une des caractéristiques du régime totalitaire était ce retournement des mots. Car d’une certaine façon les mots nous avertissent des réalités. Changer le sens des mots permet d’en faire usage, voire d’en capter la résonance positive, tout en neutralisant leur effet avertisseur. D’un côté ou ne parle plus d’avortement, mais d’interruption volontaire de grossesse. D’un autre côté on parle de mariage pour tous alors que ce qu’on vise est un lien établi juridiquement entre des personnes qui par définition ne peuvent avoir des enfants ensemble, ce qui est pourtant le sens du mot mariage et du mot enfant. S’ils veulent des enfants, ce ne peut donc être que ceux des autres, qu’ils s’approprient. Ce détournement du langage est comme on voit combiné à une tactique d’évitement, permettant de parer à la résurgence de sentiments naturels, que suscite le langage normalement utilisé. Car inévitablement la nature remonte à la surface. D’où cette société où le culte du bien-être entraîne le ‘devoir’ de faire mourir, où la stérilité est qualifiée d’hygiène reproductive, etc.
Avec une différence majeure par rapport aux romans dont nous parlions, et plus largement au monde d’avant 1960 : ce n’est plus le pouvoir d’Etat qui est au centre du processus de subversion, bien qu’il y joue toujours un rôle important : c’est la société dans son ensemble. Ceci s’est intensifié depuis l’adoption à partir des années 60 par l’ensemble du discours public, et au moins passivement par la population, du paradigme relativiste sous sa forme avancée. L’Etat sanctionne et finit par imposer les nouvelles mœurs, mais le processus se réalise maintenant d’abord dans la société elle-même ; non d’elle-même, mais travaillée par des vagues successives d’idées toujours plus « avancées » (en fait avariées). Société qui se révèle alors receler en elle sur ce plan ce totalitarisme mou et rampant dénoncé par Jean-Paul II.
Ceci dit le processus n’est pas inéluctable, car fort heureusement la réalité et la nature [1] subsistent sous cette subversion. On l’a vu dans le passé, lorsque la dérive en question est allée trop vite et trop fort. Un exemple qu’on n’aime pas citer aujourd’hui est celui de l’eugénisme, qui était au centre des thèses nazies : ce régime, qui était très moderne au mauvais sens du terme, affichait des prétentions scientifiques pour justifier ses pratiques. Et parmi celles-ci l’eugénisme et l’euthanasie figuraient en bonne place. En clair, on prétendait choisir « scientifiquement » ce qui mérite de vivre. Relisez les discours nazis sur ces deux sujets : ils sont sous cet angle d’une étonnante actualité ; on pourrait les proposer à nos politiciens. Mais le spectacle effroyable des crimes du régime a discrédité pour une période longue cet eugénisme, qui n’est remonté que lentement et récemment à la surface.
La place de la mort et de la souffrance
Parallèlement, la société actuelle a fait de la mort et de la souffrance un sujet tabou. Cela peut apparaître curieux, compte tenu de ce qu’elle accepte de plus en plus, euthanasie et avortement notamment. Mais c’est en fait logique. En effet, la mort et la souffrance sont un échec de l’idéologie dominante. La mort qu’elle cultive, c’est soit celle des autres, soit celle qu’on assume, « librement » comme on dit. Comme on l’a vu elle ne se proclame pas directement culture de mort mais met en avant la vie de ceux qui existent déjà et sont au niveau adulte. Une telle culture ne serait pleinement satisfaite que d’un homme idéalement adulte, sain et immortel, et lui sacrifierait volontiers tout le reste.
Il ne faut donc pas s’étonner de voir mis ensemble le culte de la santé parfaite et le fait pratique de la « culture de mort ». Ce paradoxe apparent s’explique par le fait que c’est le sens même de la vie qui est en cause. On l’a dit, la vie réelle est don et transmission. Aucune des formes de vies existantes ne possède une promesse de survie indéfinie sur cette terre, ni de bonheur parfait. Notre tâche en ce monde consiste à accepter nos limitations individuelles et à les dépasser par le don de la vie. Et non l’utopie de la préservation fétichique et indéfinie d’une vie existante, qui ne débouche sur rien. La culture de mort refuse cette dimension, et donc refuse la vie telle qu’elle est. Et dans son refus elle sacrifie ce qui la gêne, s’érigeant en juge du bien et du mal.
Bien entendu, nos aspirations à une forme de vie supérieure sous leur forme noble ne sont pas pour autant sans fondement ni débouché possible, pour celui qui a la foi : c’est la vie éternelle promise par Dieu. Mais vouloir la réaliser en ce monde n’aboutit qu’à sa caricature, et par là à son renversement : pour perpétuer de façon illusoire les vies existantes, on élimine brutalement les autres vies possibles si elles nous gênent, et d’abord celle de l’autre en fin de vie, et celle de l’enfant à naître. Et on définit juridiquement comme féconde une supposée union qui est par nature stérile.
Culture de mort individualiste ou communauté humaine
Il est alors possible de faire un lien entre cette culture de mort et le dépérissement du lien social. L’accueil de la vie est en effet un facteur primordial du « nous », de la communauté et de l’équilibre social. Prenons en effet la figure inverse : celle de la famille (la vraie, gardons aux mots leur sens). Rappelons ce qu’en disait le grand romancier et journaliste anglais Chesterton : c’est l’endroit où on ne choisit pas ses partenaires affectifs. Vous ne choisissez ni vos parents ni vos enfants, ni la tante Adèle, ni le cousin Georges. Mais vous apprenez à vivre avec eux et à les accepter tels qu’ils sont, et autant que possible à les aimer. C’est donc le lieu majeur d’apprentissage du lien social. Nous y prenons les êtres tels qu’ils nous sont donnés, pour être aimés.
Mais ce n’est possible qu’à condition de ne pas voir ce lien comme un contrat libre entre individus, qui peut être noué et dénoué à volonté. Si je n’aime les autres ou ne crée un lien social avec eux qu’à condition d’avoir programmé leur existence, ou du moins de l’avoir acceptée dans ma vie en gardant le droit de les éliminer, je ne crée pas de vrai lien social. Accepter la vie c’est accepter les autres comme ils nous sont donnés. Et s’ils vivent mal ou vont dans la mauvaise direction, les aider si possible à aller dans le sens du bien. Mais non pas rompre le lien. Ce qui est l’opposé exact de l’ambition contemporaine de construire l’homme et le lien social à partir d’a priori individualistes et arbitraires. Ce dont les totalitarismes nous ont montré les conséquences possibles.
(A partir d’une contribution aux Ateliers Jean Ousset en janvier 2012)
Notes
[1] Ce dont je parle ici n’est bien sûr pas d’abord la nature biologique, mais la nature humaine au sens classique, dans ce qu’elle comporte d’appel à la réalisation de ce pourquoi nous sommes faits, qui nous réalise pleinement, et qui est d’abord spirituel.
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Imprimer
Imprimer