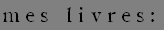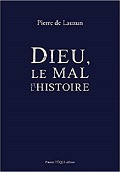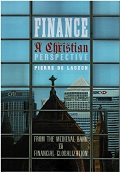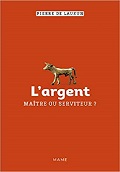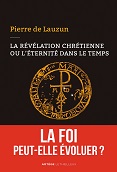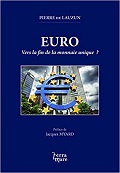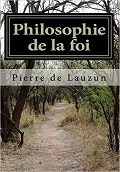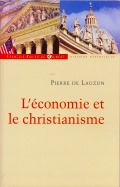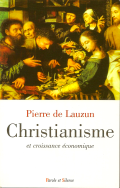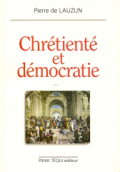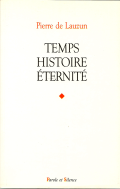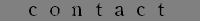
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
Le dérèglement social, des sociétés animales aux sociétés humaines
samedi 12 avril 2025
Paul Valéry disant que nos civilisations sont mortelles : il pensait au drame de 14-18. Et il y a bien d’autres exemples de sociétés qui ont disparu.
Il est à ce sujet intéressant d’examiner les mécanismes possibles pouvant conduire à ce résultat, y compris en partant d’expériences animales comme celle de John Calhoun.
L’expérience Calhoun
A partir de 1958, John B. Calhoun mena des expériences de surpopulation chez les rats (‘Univers 25’). Son sujet premier était la question de l’espace. Mais cette expérience offre une matière à réflexion bien plus large.
Les données
Selon Wikipédia, « Calhoun a fourni une cage à des rats avec de la nourriture et de l’eau en quantité suffisante pour soutenir toute augmentation de la population. En revanche la cage avait une taille jugée suffisante pour seulement 50 rats. La population a culminé à 2200 rats…et, par la suite, a montré une variété de comportements anormaux, souvent destructeurs. Sa conclusion était que l’espace lui-même est une nécessité. Des études ultérieures impliquant les humains ont montré que ce n’est pas le simple manque d’espace qui provoque ce phénomène. C’est la nécessité pour les membres de la communauté d’interagir entre eux. Lorsque les interactions forcées dépassent un certain seuil, les normes sociales cèdent… Les rats développent des comportements extrêmement anormaux pouvant mener à l’extinction de la population ».
Il n’y a donc rien en terme physiques qui explique ce ralentissement : tout se passe au niveau social et comportemental. Des phénomènes divers apparaissent, affectant les comportements sexuels et maternels. Les mâles dominants excluent les autres de la reproduction, qui errent alors, devenant soit agressifs et en bande, soit isolés ; ils attaquent les femelles et les plus jeunes. Certains mâles deviennent exclusivement homosexuels ou hypersexuels ; ou ne se soucient plus de reproduction. Les femelles, excessivement sollicitées, s’isolent et ne sortent plus ; parfois elles abandonnent leurs petits ou les attaquent, et finissent par ne plus se reproduire. Il y a même ce que Calhoun a appelé un ‘cloaque comportemental’ : « les animaux s’entassaient ensemble en grand nombre dans un seul des quatre enclos interconnectés où résidait la colonie... dans l’enclos dédié à l’alimentation, laissant des populations clairsemées dans les autres enclos. »
Ces rats, pourtant sociaux en soi, deviennent donc individualistes et ne s’occupent plus que d’eux-mêmes. La population décline puis la reproduction s’arrête, les rares jeunes ne survivent plus que quelques jours. Ensuite la population s’effondre. L’espace redevient disponible, et les rats sont encore à même de procréer. ; mais l’esprit social a disparu, et rien ne contrebalance la dérive. Même mises en contact avec des congénères normaux, les dernières femelles ne changent pas de comportement et se contentent de manger et de dormir, sans procréer.
Voilà donc des animaux ‘sociaux’ qui finissent par adopter des comportements asociaux alors qu’il n’y a aucun problème de ressources ; comme si les derniers membres n’avaient plus les moyens ‘mentaux’ (et sociaux) de redémarrer.
Les leçons
La question de l’espace, objet initial de l’expérience, est évidemment une des causes majeures de ce dérèglement, notamment avec la multiplication excessive des interactions entre sujets. Mais un autre facteur explicatif essentiel est le fait que ces animaux n’avaient plus de défi, plus rien à accomplir, plus de lutte contre l’adversité, source de cohésion sociale. Dit autrement, ce groupe n’était plus confronté aux causes de mort que l’on trouve dans la nature (privation de nourriture, prédation, maladie etc.). Et ces deux facteurs s’ajoutent : trop d’interactions sans but ni sens créent assez logiquement de la violence inutile, puis la lassitude et l’abandon.
Mais à côté des causes possibles, il reste deux constatations troublantes. La première est que l’effet n’est pas purement rationnel et adaptatif : si la cause n’était que l’espace, l’effet devrait être en rapport. Or ce qui se dérègle, c’est l’ensemble des rapports sociaux et des comportements individuels. En outre, ce que Calhoun appelle ‘cloaque comportemental’, à savoir une accumulation des rats dans certaines parties, montre que cela aboutit entre autres à une restriction de l’espace, cette fois volontaire, et non à une dispersion. Enfin, si la remise en cause de la reproduction peut s’expliquer par la question de l’espace, elle devrait s’arrêter avec la baisse de la population. Or, deuxième constatation importante, les comportements acquis à cette occasion ne cessent plus après. Ils ont pu être dans une certaine mesure fonctionnels (face à la surpopulation), mais ils subsistent au-delà.
Ce qui apparaît donc est que l’explication par l’espace ne suffit pas, et donc que l’absence de défi joue un rôle a priori important aussi. Mais surtout qu’il y a eu une sorte de déstructuration culturelle : les rats ont progressivement en quelque sort désappris les modes de comportements normaux, permettant à des groupes de se renouveler. Et cette déstructuration devient une sorte de nouvelle nature, qui persiste ensuite, aboutissant à leur disparition.
Et notre société ?
Evidemment, l’être humain est plus complexe que de simples souris de laboratoire. Mais ce sont aussi des êtres sociaux, et les relations qu’ils ont avec les autres sont décisives pour leur survie. Notamment la qualité des liens affectifs, le souci des enfants et de leur éducation, en un mot de la famille. Si donc ils peuvent prendre du recul par rapport à ce qu’on appelle chez les animaux l’instinct, ce qui s’y ajoute et en partie s’y substitue est un ensemble de traits culturels et de comportements, qui peut parfaitement dériver, tout comme celui des rats dans cette expérience.
On a souligné justement la ressemblance de cette expérience avec certains traits de la société actuelle : l’individualisme évidemment, enraciné dans une idéologie dominante ; la violence ; les comportements asociaux et déviants ; ou l’idée qu’on n’a rien à accomplir. Et bien sûr l’effondrement des taux de natalité. Ce qui conduirait à s’inquiéter pour l’avenir. Sur ces points effectivement, la ressemblance est directe ; or dans le cas humain, il est douteux que la restriction d’espace soit le facteur explicatif principal – même si l’entassement urbain y fait penser, car l’humanité a connu d’autres cas d’entassement sans produire les mêmes effets, en Asie par exemple. Il faut donc recourir à l’explication par les facteurs culturels : soient que ceux-ci n’aient pas permis de réagir à une situation défavorable (entassement ou abondance excessive de biens), soit qu’ils aient évolué dans un sens contreproductif, ou les deux ensemble. C’est ce qui paraît le plus probable.
On peut d’ailleurs ajouter à la dénatalité d’autres dérèglements majeurs de nos sociétés, tout aussi dysfonctionnels, par exemple l’empilement des dettes, ou les risques écologiques. Or aucun des deux n’a à voir avec l’entassement, mais résultent de pratiques collectives déviantes – potentiellement meurtrières à terme, si un virage majeur n’est pas pris.
Mais il est un point à souligner, qui n’est d’ailleurs pas sans rapport avec l’expérience des rats, qui est qu’un comportement qui a pu apparaitre adapté et justifié peut devenir contreproductif, si les intéressés s’y attachent et le valorisent. On trouve ici le rôle pervers que peuvent avoir des idéologies, laïques ou religieuses. Un exemple fameux d’un tel désastre est celui des habitants de l’île de Pâques, qui pour fabriquer leurs célèbres statues à motif religieux ont progressivement déboisé toute l’île et créé une catastrophe écologique. Or, de leur point de vue, faire ces statues était une cause noble.
C’est sans doute ce qu’on observe dans nos sociétés. Car ce n’est pas seulement la consommation qu’il faut incriminer, mais toute une idéologie devenue dominante avec le postmodernisme, l’idéologie du droit pour chacun de faire ce qui lui plaît sous réserve du droit identique du voisin - dernier effet d’un paradigme de neutralité présent depuis trois siècles. D’où, entre autres, l’oubli de tout sens de la communauté, sauf comme source de prébendes et de protection juridique (idéologie des droits) et une individualisme maladif. Et plus encore, l’oubli du sens de la responsabilité envers la postérité et la descendance, et donc la famille, pourtant au centre de toutes les sociétés antérieures.
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Imprimer
Imprimer