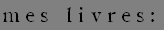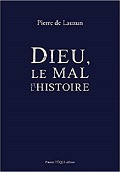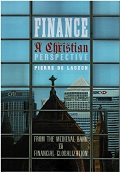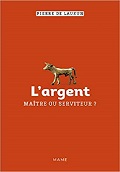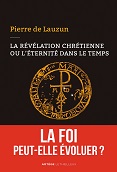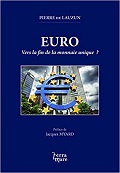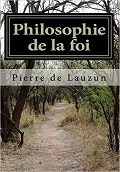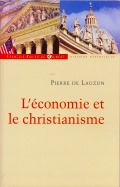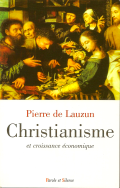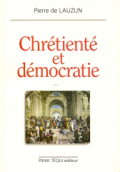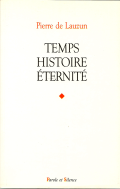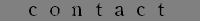
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
Léon XIV et le grand chantier de la Doctrine sociale de l’Eglise
mercredi 21 mai 2025
Il est évidemment trop tôt pour prévoir les grands axes du nouveau pontificat. Mais nous avons un indice : le nom du nouveau pape. On a expliqué pourquoi il avait été choisi : par référence à Léon XIII et à son encyclique Rerum Novarum (1891), lancement de la Doctrine sociale de l’Eglise (DSE). Et le pape l’a confirmé. La Doctrine sociale de l’Eglise devrait donc être un des points majeurs d’attention du pontificat.
Un nom qui est tout un programme
En choisissant Léon, le nouveau pape a d’emblée posé deux actes significatifs. D’un côté, il a évité le piège de l’identification à un de ses prédécesseurs immédiats : ni Pie XIII, ni Jean XXIV, ni Paul VII, ni Jean-Paul III, ni François II. Pas d’étiquette posée à l’avance ; pas d’identification avec un camp ou un autre. Mais d’un autre côté, il n’a pas voulu poser un acte hors-série, avec un nom jamais porté comme François ; ou porté il y a très longtemps et parlant peu aux contemporains, comme Clément, Nicolas ou Martin. Il a pris un nom de pape typique (le quatorzième), mais d’un pape relativement proche, dont les actes majeurs ont une résonance aujourd’hui (la Doctrine sociale justement). Nom qui est en outre celui de papes importants, en particulier d’un des deux papes fondateurs du premier millénaire qualifiés de ‘grands’ : Léon Ier. Pape du courage : c’est l’homme qui a arrêté Attila en allant le confronter personnellement ; et c’est l’homme qui a remis sur la bonne voie une controverse qui dérapait en concile (le « Tome à Flavien » sur la double nature du Christ). Ce que Léon XIV ne peut évidemment pas ignorer, et donc qu’il assume. Il s’inscrit donc résolument dans une continuité ; ce qui est en cohérence avec son apparence à la tribune de Saint Pierre, avec mozette et étole.
Mais ce n’est pas pour afficher pour autant un programme de restauration. La référence à Léon XIII, l’homme de Rerum Novarum (« des choses nouvelles ») permet de mettre l’accent sur l’avenir. Naturellement, nos médias ont insisté sur la dimension sociale au sens actuel, alors que la Doctrine Sociale parle de la société humaine en général – qui inclut le social au sens usuel. Bien entendu, Léon XIV a confirmé depuis sa sensibilité sociale en ce sens étroit (notamment l’attention aux pauvres et exclus). Mais il a précisé aussi que, de même que Rerum Novarum parlait de questions de son temps (la condition ouvrière), il compte aborder les développements nouveaux en la matière, notamment l’ère digitale et l’intelligence artificielle - avec ses conséquences pour l’emploi. Là aussi, il a évité de se laisser enfermer dans des cases définies à l’avance.
Pas l’homme des cases et étiquettes
Intervenant le 17 mai devant les membres de la Fondation Centesimus annus Pro Pontifice, dédiée à la Doctrine sociale, il a tenu un discours équilibré, soulignant le rôle du dialogue et de la rencontre (comme entre patrons et ouvriers au temps de Rerum Novarum), notamment dans l’écoute des pauvres. Il a souligné aussi l’importance de la méthode, de la manière d’aborder les problèmes (plus que l’énonciation de solutions, ce que le terme de doctrine évoque chez certains) : la doctrine est pour lui élaboration progressive au vu des situations nouvelles et des ‘signes des temps’ à scruter (dont la ‘révolution digitale’), mais un développement dans la poursuite de la vérité et il insiste sur la rigueur nécessaire dans ce processus.
Si donc il insiste, en perspective chrétienne, sur l’attention aux pauvres et leur écoute, il ne développe pas à ce stade des sujets attendus comme les migrants, mais plutôt le contexte nouveau de la digitalité. Là aussi il évite qu’on l’étiquette. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne parlera pas de ces sujets à l’avenir. Il y aurait grand intérêt à clarifier par exemple le débat sur l’ordo amoris (pour simplifier, doit-on donner la priorité à ses proches et par là aussi à son pays ?), qui mérite mieux que la réponse à l’emporte-pièce du pape François, qui revient à nier la question. D’autant que le nouveau pape a l’image d’un homme d’écoute ; or même si la formule de Vance peut être critiquée comme simpliste, le pasteur universel qu’est le pape se doit de répondre au souci exprimé. Mais Léon XIV, si on a bien compris, ne voudra le faire qu’au moment approprié, après mûre réflexion. Gageons aussi qu’il voudra éviter le choc frontal avec Trump que nos chers médias attendent avec gourmandise ; ce qui ne veut pas dire qu’il ne sera pas ferme et courageux quand et là où il le faudra.
En fait, c’est sur la DSE en général qu’on peut légitimement l’attendre. Tout indique qu’elle devrait être un des grands chantiers du pontificat.
La Doctrine sociale : une urgence
Quel étrange sort que celui de la Doctrine sociale ! Après l’impulsion immense donnée par Léon XIII, elle s’est développée jusqu’au Concile, mais a connu ensuite, dans le milieu qui donnait le ton, l’aile progressiste, une défaveur profonde hors exceptions, et été même traitée d’ « idéologie » par des théologiens de premier plan. C’est saint Jean-Paul II qui l’a remise en selle, avec des textes majeurs, dont Centesimus annus en 1991, et une mise en forme ordonnée et rationnelle, le Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise (2004). De façon étonnante, cela a débouché non seulement sur un intérêt considérablement plus grand pour cette Doctrine, mais aussi sur son adoption par tout le spectre de sensibilité catholique, y compris progressiste (qui croient qu’elle l’est). Encore développée sous Benoît XVI, elle l’a été sous François, Laudato si’ entrant dans son champ, mais aussi Fratelli tutti (même si son statut doctrinal est moins net).
D’où un double risque. Le premier est celui de la confusion entre le champ d’intervention du magistère, qui concerne la foi et les mœurs, en l’espèce les principes moraux applicables à la vie sociale ; et ce qui revient aux laïcs : la responsabilité de la politique à suivre dans le respect de ces principes. Or la frontière entre principes et politiques n’est pas toujours facile à discerner, comme l’exemple du pape François l’a montré. Risque accentué par le fait que la DSE comporte par nature une partie liée aux circonstances.
Le second risque est de trop mettre l’accent sur ces seules questions, en occultant de fait le cœur de la foi, le besoin de conversion, priorité naturelle des pasteurs de l’Eglise, et notamment du premier d’entre eux. Mais au vu de ce qui a été noté du pape Léon XIV, on peut penser qu’il saura trouver la ligne juste.
Un grand chantier
Reste qu’il y a beaucoup à faire dans ce champ de la DSE, outre ce qu’a mentionné le pape. Déjà au niveau des principes, des notions comme le bien commun ou la dignité de la personne humaine, très utilisées dans les textes, se révèlent à la réflexion moins clairs qu’il n’y paraît, le second surtout. De même pour les Droits de l’homme, apparemment communs avec la société ambiante, mais compris en réalité de façon assez différente. Il faut aussi assurer la cohérence du magistère dans le temps, et aborder courageusement des questions laissées en suspens entre doctrines récentes et positions anciennes, comme la liberté religieuse ou le taux d’intérêt.
S’y ajoute toute une série de questions majeures encore en suspens. Le rôle de l’Etat au service du bien commun, traditionnellement reconnu, mais mis en doute par le pape François dans Fratelli tutti. Les migrations, entre accueil des personnes en souffrance et maintien de la communauté nationale. Les inégalités, qu’il ne suffit pas de dénoncer. L’investissement éthique, sujet majeur en finance. La protection sociale, bien intentionnée mais coûteuse. Mais aussi la notion d’écologie humaine, face à une écologie ambiante qui a des vues très différentes. Ou la démographie, entre liberté des couples et impact sur la société. Et bien sûr, la place de la femme dans la communauté, avec l’immense question du travail domestique. Etc.
De quoi bien remplir un pontificat…
A paraître sur Politique Magazine
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET
 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Imprimer
Imprimer