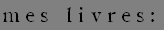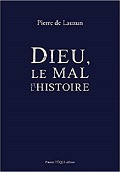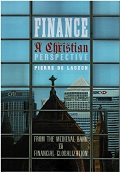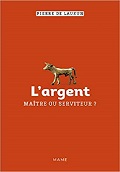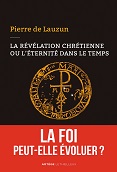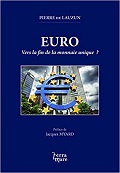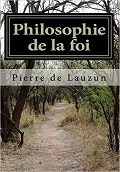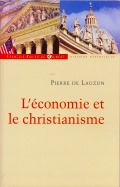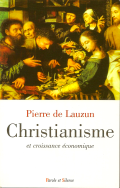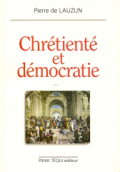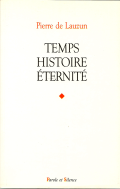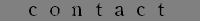
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
POLITIQUE
Articles de cette rubrique
-
Une tentation liberticide dans l’écologie ?
Publié le dimanche 4 février 2024
La question posée rencontre un écho immédiat, car nous percevons trop souvent chez ceux qui se réclament de l’écologie la tentation de régenter la vie de leurs semblables.
Le cas de l’écologisme est toutefois spécifique. Ce qui le caractérise est le lien affiché entre des affirmations scientifiques et des prétentions moralisantes : c’est rare. Mais ces analyses prévoient un avenir catastrophique, avec l’idée d’une urgence à agir. Elle sont donc pourvues d’une charge émotionnelle et moralisante intense.
D’où la tentation autoritaire.
Suite…
(Paru dans La Nef février 2024)
-
Censure de la loi immigration : un tournant dans le régime
Publié le vendredi 26 janvier 2024
Cette censure, venant après un débat délirant, est un tournant majeur.
Sur le fond, les juges s’asseyant sur le processus démocratique.
Sur la vie politique, puisqu’aucune majorité même cas par cas n’est plus possible au Parlement pendant 3 ans.
Suite…
-
Famille et vie professionnelle : changer de paradigme
Publié le jeudi 21 décembre 2023
Toute personne a deux responsabilités majeures à assurer dans la société : son rôle professionnel, et sa vie familiale. Celle-ci est tout aussi décisive que l’autre, car par elle la société se renouvelle et assure la formation des générations futures. Abordée traditionnellement sous le seul angle de la natalité, cette exigence est donc bien plus large. Or la gestion simultanée de ces deux responsabilités n’est pas simple, notamment pour les femmes. Il faut donc y travailler en priorité.
Mais notre société ne raisonne pas ainsi. Culturellement individualiste, elle laisse les individus se débrouiller et gérer leurs contraintes plus ou moins contradictoires, avec finalement peu de soutien et de reconnaissance - hors certaines prestations.
Il faut donc renverser les priorités : ce que chacun fait pour sa famille est aussi important pour la société que le travail accompli à l’extérieur, et doit être pris en compte et soutenu comme tel.
Suite…
-
Gaza, migrations : peut-on parler de conflits de civilisations ?
Publié le dimanche 10 décembre 2023
L’actualité récente a été marquée par une recrudescence de crimes gratuits liés à l’immigration. Le milieu médiatique et politique tend à les relativiser ; l’opinion publique est bien plus sévère et inquiète ; elle reconnaît qu’il y a là un grave problème. Ces incidents entrent en outre en résonance avec la guerre en cours à Gaza.
Faut-il pour autant parler de conflit de civilisation ? de guerre civile potentielle ? C’est ce que font E. Zemmour et d’autres. Mais la réflexion montre qu’il y a danger à appliquer cette grille de lecture sur le conflit à Gaza et a fortiori sur la situation nationale française.
Il est impératif d’agir, et vite, mais sans jouer le conflit frontal.
Suite...
-
Qu’une guerre est juste ou pas s’apprécie dans le temps et cela peut changer avec les faits : Ukraine, Gaza
Publié le lundi 4 décembre 2023
Venant après la guerre d’Ukraine, la guerre à Gaza a remis sur le devant de la scène la question de de la guerre juste. Mais la plupart des réactions se caractérisent par une dominante extrêmement émotionnelle, certes compréhensible, mais qui envoie les uns et les autres dans des directions complétement divergentes, et ne donne pas de repères pour le jugement. Par ailleurs, il n’est que très rarement fait référence à la réflexion sur ce qu’on peut qualifier de guerre juste. Celle-ci est pourtant une aide précieuse pour le jugement et pour l’action. Et pour échapper aux manipulations à prétexte moralisant.
Mais il est un point important qui est encore plus négligé : la possibilité que ce jugement puisse évoluer dans le temps, en fonction du déroulement des opérations d’une part, de l’évolution des buts de guerre réels de l’autre. Le fait qu’une guerre soit considérée juste au départ, par exemple en réponse à une agression caractérisée, n’implique pas que les décisions prises ultérieurement le soient aussi. Et il faut savoir reconnaître quand le déroulé des combats et conséquemment l’évolution des enjeux changent les données du raisonnement initial.
Suite…
Paru sur le site de Géopragma.
-
Sur la condition de la femme dans la société actuelle
Publié le mercredi 22 novembre 2023
L’évolution considérable et par bien des côtés positive de la condition féminine dans nos sociétés continue de soulever bien des interrogations. Non sans motif, car la question est loin d’être stabilisée.
Le cadre de pensée postmoderne actuellement dominant est ici particulièrement nocif, occultant certains problèmes et en créant d’autres. Il faut donc reprendre la réflexion sur d’autres bases, en prenant en compte des évolutions souvent bénéfiques - mais aussi l’apparition de difficultés nouvelles, notamment pour les femmes elles-mêmes. Plusieurs livres récents peuvent nous y aider.
Cela suppose aussi de rappeler certaines réalités de base, dans la ligne de la pensée classique. Elles concernent tant la reconnaissance de la spécificité des femmes et des hommes, que les exigences du plein développement de la vie humaine : celle-ci suppose des communautés de personnes, orientées vers le bien commun et donc le bien de tous leurs membres ; et parmi ces communautés, notamment, la famille.
Suite…
-
Le conflit de Gaza est-il une guerre juste ?
Publié le samedi 4 novembre 2023
Je sais bien que ce n’est pas très populaire ni jugé très crédible, mais je vais examiner ici la question sous l’angle moral, celui de la notion de guerre juste, selon la conception classique de celle-ci.
On verra alors que si le souci de défense et d’éradication des terroristes est indiscutable, la guerre en question présente un dilemme moral redoutable. Et surtout elle ne pourra être qualifiée de juste que si elle débouche sur une paix raisonnablement équitable, comportant donc une place pour les Palestiniens (hors Hamas).
Suite…
-
Le conflit israélo-palestinien : la frustration d’un conflit sans bonne solution
Publié le jeudi 19 octobre 2023
Le conflit israélo-palestinien paraît être l’exemple parfait d’un conflit sans bonne solution. Cela exaspère les belles âmes, mais aussi les hommes de bonne volonté. C’est pourtant la réalité qu’il faut reconnaître pour agir dans la mesure du possible.
Malgré l’actualité brûlante, nous allons essayer de l’analyser ici de la façon la plus dépassionnée possible.
Suite…
-
Le paradoxe du terrorisme : révoltant, inhumain, mais en définitive inefficace
Publié le mardi 10 octobre 2023
Nous sommes tous marqués par le terrible massacre en Israël : un massacre de civils paisibles et sans défense, et prise d’otages massive.
Mais j’évoquerai ici un point plus spécifique : y a-t-il dans certains cas au moins une légitimité possible au terrorisme comme forme de lutte ?
La réponse est non, et plus généralement, le terrorisme se révèle presque toujours comme stupidement contre-productif.
Suite…
-
Armée nationale, esprit guerrier et stabilité politique
Publié le lundi 2 octobre 2023
La théorie qui définit l’Etat comme ayant le monopole de la force ne nous dit pas ce qu’est cette force. Dans toute entité politique, un enjeu essentiel est donc de savoir qui détient la force effectivement.
Concrètement, dans une société humaine la force pour être force suppose la réunion de deux éléments : des moyens matériels ; mais aussi voire surtout un esprit de combat, en un sens un esprit guerrier, qui doit exister dans la société et être entretenu puis mobilisé. Normativement, cette force doit alors bien sûr être construite de façon à œuvrer pour la société en question, en étant loyale au pouvoir politique légitime.
Tout cela paraît trivial, mais dans la réalité cela ne va pas de soi et l’histoire le prouve ; dans nos sociétés, c’est considéré comme automatiquement réalisé, alors que rien ne le garantit sur la durée longue.
Paru le 2 octobre 2023 sur le site de Géopragma.
Suite…
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET