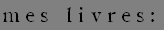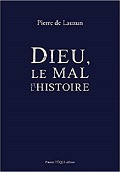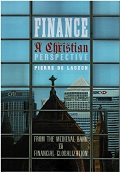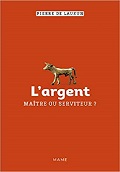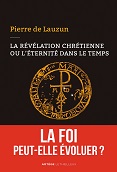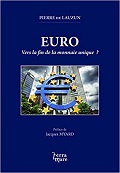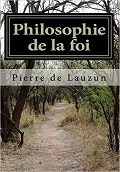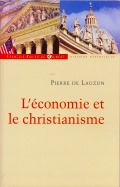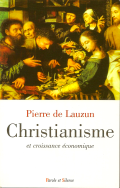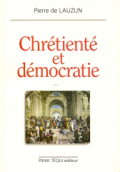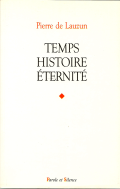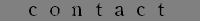
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
POLITIQUE
Articles de cette rubrique
-
Europe et démocratie
Publié le jeudi 28 avril 2022
L’Europe se présente comme le temple de la démocratie.
Dans le discours dominant, ce qu’on appelle ‘valeurs européennes’ et ‘valeurs démocratiques’ sont pratiquement synonymes. On a l’air de considérer cela comme allant de soi. En fait ce n’est ni cohérent ni prometteur. La démocratie comme gouvernement du peuple est sacrifiée à la démocratie comme programme idéologique.
Suite…
-
La 5e république dans l’impasse ?
Publié le samedi 16 avril 2022
Les élections en cours laissent bien des électeurs très insatisfaits. Ils le seraient plus encore s’ils prenaient pleinement conscience de l’impasse qui apparaît dans le fonctionnement même de la 5e république, que les élections législatives qui suivent mettront plus nettement en lumière. D’où le besoin d’une réflexion sur les institutions, même si le problème est bien plus profond.
Suite…
-
La guerre d’Ukraine : pour une politique nationale
Publié le mardi 29 mars 2022
On tend trop souvent à analyser la guerre d’Ukraine en termes émotionnels, ou comme grande lutte des régimes autoritaires et des régimes démocratiques. Je me placerai ici sur un plan différent : celui des relations internationales. Pour me concentrer sur les leçons à en tirer pour la détermination d’une politique nationale pour la France.
Suite…
-
La guerre en Ukraine et la notion de guerre juste
Publié le mardi 15 mars 2022
La théorie traditionnelle de la guerre juste a été remise en cause ici est là, et notamment récemment par le pape François. Or nous avons en Ukraine une guerre de grande ampleur, assez classique, dans un contexte européen. Outre les belligérants, les positions qu’elle suscite sont tranchées, et se situent sur le terrain moral, en général pour condamner l’agression. Que peut-on en dire du point de vue de la théorie de la guerre juste, exposée de façon classique par l’Eglise catholique ?
Suite…
-
Pertinence maintenue de l’opposition droite-gauche
Publié le samedi 12 mars 2022
L’opposition droite-gauche structure la vie politique de nos démocraties depuis le XIXe siècle au moins. Le contenu de ces deux termes a beaucoup varié, mais pas le rôle structurant de cette opposition.
Certains veulent pourtant y substituer d’autres clivages. Notamment entre peuple et élites, souverainistes et mondialistes, ou nomades et enracinés.
Mais comme nous allons le voir, cela ne remet en réalité pas en question l’opposition droite-gauche
Suite…
-
La guerre d’Ukraine : quelques leçons
Publié le jeudi 3 mars 2022
Je n’ai pas une forte expertise militaire ni du monde russe. Et beaucoup dépendra des événements, notamment sur le terrain. Mais cela n’empêche pas de proposer un raisonnement d’un point de vue de citoyen français.
Face à cette agression caractérisée, même si elle s’inscrit dans un contexte plus complexe qu’on ne le dit, le point central est de se rappeler que nous sommes un pays souverain dans un monde dur, où chacun doit prendre ses responsabilités et s’organiser en conséquence, y compris pour œuvrer en faveur de la paix.
Suite…
-
Zemmour et la reconstruction de la droite : perspectives
Publié le mardi 1er février 2022
L’irruption du phénomène Zemmour a permis une revitalisation du débat politique à droite et l’ouverture d’alternatives jusque-là compromises.
Mais si on admet que son élection est peu probable au vu des données actuelles, que peut-on attendre sur la durée de ce phénomène ?
Suite…
-
Conquête et pouvoir des minorités
Publié le mercredi 12 janvier 2022
Le poids des minorités militairement supérieures est une constante de l’histoire. L’archétype en est donné par les invasions barbares au Ve siècle. On retrouve des faits analogues ailleurs.
Le verdict de l’histoire est clair : ce n’est pas le plus civilisé qui gagne, celui qui est porteur de plus de valeurs ou de savoir-faire : c’est en termes brutaux le meilleur guerrier.
Suite…
-
Le politiquement correct, Zemmour et les conservateurs
Publié le mercredi 5 janvier 2022
Depuis quelque temps, on parle beaucoup plus de la bataille des idées en politique. On cite alors volontiers les idées de Gramsci et son concept d’hégémonie : l’idée que le système de pensée dominant, celui qui structure la pensée, le débat et l’action collectifs, était décisif pour une victoire réelle. Dans la situation actuelle, l’hégémonie reste de gauche ou ‘progressiste’. Quel sens prend alors l’irruption du phénomène Zemmour ?
Suite…
-
Confucianisme et société moderne (deuxième partie)
Publié le mardi 14 décembre 2021
Le confucianisme a imprégné toutes les sociétés d’Extrême-Orient, et explique par-là bien de leurs caractéristiques. Il connaît actuellement un regain en Chine, tant au niveau populaire que par récupération (plus ou moins abusive) dans la propagande du régime ; ainsi que dans le champ intellectuel.
Tout cela justifie de se pencher avec attention sur ses messages. Et cela d’autant plus que dans la compétition mondiale des régimes politiques, il peut avoir une influence décisive sur ce qui parait pouvoir être la puissance dominant le monde de demain – la Chine.
Je propose deux articles , le premier portant sur l’héritage de la pensée confucéenne, le second sur sa pertinence actuelle, notamment dans le champ politique.
Deuxième article : le confucianisme aujourd’hui
Suite…
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET